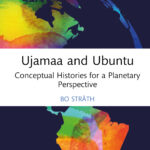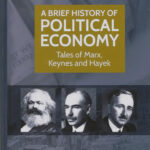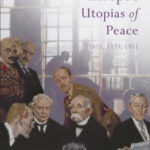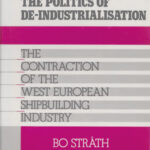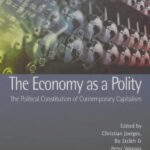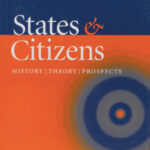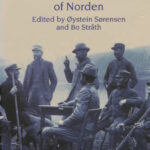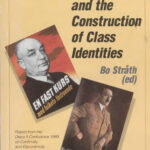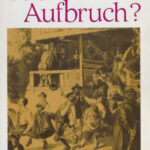Conférence publique, Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de Bruxelles, "Journée de l'Europe", 8 mai 2025

Mesdames et messieurs, chers et chères collègues, auditeurs et auditrices,
Le titre que je vous ai proposé comporte l’un de ces paradoxes logiques dont une certaine tradition philosophique est coutumière. Il pourrait n’être qu’une façon de conférer à bon compte une aura spéculative à de banales considérations sur les contradictions et les conflits qui grèvent la réalisation d’un projet fédéral accompagnant les institutions politiques dont – dans des « géométries » variables – s’est progressivement dotée l’Europe supranationale surgie de la « résolution » des conflits qui l’avaient déchirée au cours du XXème siècle : les deux Guerres Mondiales, puis la « Guerre Froide ». Ce projet reçoit bien entendu des définitions variées, voire antithétiques, il ne cesse de susciter des objections et des résistances, parfois de l’intérieur même de ses organes officiels. Il n’en est pas moins avéré, et pour beaucoup d’entre nous, comme pour une large part des citoyens européens, il bénéficie désormais d’une sorte d’évidence. Ne serait-ce que celle du fait accompli. Pourtant, tout se passe comme si sa légitimité, la certitude de son achèvement, la garantie même de sa pérennité, ne pouvaient jamais être tenues pour acquises. En revenant, pour les besoins de cette conférence, à quelques-unes des références obligées de la « science politique » au sujet de la construction européenne et de son incarnation dans l’Union, j’ai trouvé plusieurs expressions de ce paradoxe. Par exemple celle-ci, dans le titre même de la Préface rédigée par Yves Mény pour le numéro de la Revue Européenne consacré en 2016 au « Fédéralisme européen » : « L’Union européenne et le fédéralisme : Impossible ou inévitable ? ». [1] Le contenu suggère qu’il y a impossibilité en un sens et inévitabilité en un autre, mais que comme ces deux sens sont également requis par l’histoire des institutions, la contradiction est insurmontable, bien que mouvante dans son contenu et ses effets. C’est dans les périodes de crise, ou de conflit aigu, que le paradoxe est porté à son comble, et je pourrais laisser croire que ma formulation, légèrement différente, exhibant l’unité de contraires, n’est qu’une façon rhétorique de dramatiser ses enjeux.
Mais j’ai voulu suggérer quelque chose de plus. Je me suis souvenu que plusieurs fois déjà dans le passé, peut-être par une propension théâtrale à jouer les Cassandre, j’avais identifié des moments de crise aiguë avec la possibilité ou l’imminence d’une « fin de l’Europe », c’est-à-dire d’une effondrement ou d‘une dissolution de l’Union en tant que construction fédérale ou quasi-fédérale. Par exemple au moment de l’écrasement de la résistance constitutionnelle de la Grèce aux injonctions de l’Eurogroupe en 2015. [2] Je convoquais ainsi implicitement, sur un mode mi-stratégique, mi-eschatologique, des analogies avec la dissolution d’autres constructions supranationales dans l’Europe moderne, pourtant fondées sur des principes radicalement différents, dont on avait pu croire qu’elles étaient irréversibles. Indépendamment de la fragilité du diagnostic, ce qui semblait caractéristique de la conjoncture était alors un redoublement des contraintes externes par l’aggravation d’un conflit interne à l’Europe. Mais la situation actuelle qui n’est pas moins critique semble marquée par une tension très différente entre des signaux contradictoires venus respectivement de l’extérieur et de l’intérieur. D’un côté en effet, la guerre qui se déroule aux portes de l’UE, et dont elle est en réalité partie prenante (je veux parler de la guerre en Ukraine, même si je pense qu’à certains égards le génocide palestinien est encore plus grave et ne retentira pas moins sur l’avenir de l’Europe), avec ses derniers développements géopolitiques résultant de la volte-face américaine, est largement interprétée comme l’ouverture paradoxale d’une possibilité de bond qualitatif dans l’intégration des nations européennes : il s’agirait ni plus ni moins de la résurrection du vieux projet de la « Communauté Européenne de Défense », aujourd’hui soutenu par les mêmes Etats qui, dans les années 50, l’avaient fait échouer. Etape décisive dans le transfert des marques de la souveraineté étatique de l’échelon national à l’échelon fédéral, dont les conséquences se feront sentir – si elle a lieu – dans tous les domaines de la vie économique et politique des Etats membres, sans oublier la conscience communautaire de leurs citoyens. Mais d’un autre côté, la montée de ce qu’on appelle les mouvements « populistes », dont plusieurs sont ouvertement nostalgiques du fascisme et du nazisme des années 1920-1940, leur accession au pouvoir dans plusieurs pays européens, leur capacité « hégémonique » au sein de la classe politique et de la population, les appuis dont ils bénéficient de la part d’impérialismes à la fois rivaux et convergents idéologiquement, donnent à penser que les analogies avec la période dans laquelle s’était effondrée la capacité de l’Europe à civiliser le conflit politique, ne sont pas dépourvues de signification. C’est cette nouvelle configuration particulièrement dramatique et inattendue de la tension inhérente au rapport que l’Europe entretient avec sa propre possibilité institutionnelle, que je me suis proposé de discuter aujourd’hui, en évoquant une partie au moins des questions dont il faut l’assortir pour que le caractère inévitable, ou au contraire indéterminé, des évolutions en cours et de leurs conséquences, ne fasse pas simplement l’objet d’une intuition ou d’un pari.
*
La première série de problèmes que je voudrais formuler concerne le rapport que la construction d’une Europe communautaire entretient avec le monde environnant dont elle est à la fois dépendante dans sa définition même en tant qu’ensemble de nations, et séparée par des histoires, des frontières, des antagonismes, des inégalités de développement et de situation. Je vais naturellement essayer de caractériser du mieux possible l’effet qu’induit la transformation du cadre « géopolitique » sur la construction européenne, c’est-à-dire sur les modalités du rapport de « souveraineté » entre nationalité et supranationalité. Mais je voudrais aussi, contre une certaine tendance favorisée par la conjoncture actuelle dans le discours savant et dans l’opinion publique, insister sur le fait que le « monde » avec lequel l’Europe est en relation et dont elle dépend ne peut être défini purement et simplement en termes d’alliances et de conflits entre des Etats ou des Empires continentaux. D’autres dimensions non moins fondamentales et irréductibles entre elles doivent être prises en considération. L’enjeu de cette réflexion semble concerner notamment l’articulation des notions de puissance et d’indépendance, dont dépendent à leur tour les conceptions du risque, de la sécurité, de l’identité. La proposition actuelle est que dans un « monde » de plus en plus périlleux, voire directement menaçant pour l’Europe, dans lequel les « fronts » sont susceptibles à la fois de s’embraser et de se renverser de façon imprévisible, le niveau stratégique d’organisation et d’équipement ne peut plus être que fédéral. Une Europe qui cherche à continuer sur sa trajectoire propre ne peut ni en rester à la concurrence des nations ni demeurer otage des protections ou des sujétions d’une époque révolue. Je n’en disconviens pas. Mais les notions sous-jacentes demandent clarification.
Il convient, même très brièvement, de s’arrêter sur ce que signifient indépendance et rapport au monde dans le cas d’une entité comme l’Europe, dont l’identité est entièrement conditionnée par les traces et les effets actuels de ses vieilles divisions internes, mais aussi des rapports que ses composantes, ensemble et séparément, ont entretenus avec le reste du monde. L’un n’étant d’ailleurs pas dissociable de l’autre. Dans les deux cas les rapports se sont cristallisés dans le tracé de frontières (ou de super frontières politiques et culturelles) qui se déplacent constamment mais survivent à leur effacement juridique, et dans les modalités de leur transgression. La tension palpable qui existe aujourd’hui entre la façon dont le contexte géopolitique et notamment les relations avec la Russie sont perçus à l’Ouest et à l’Est de l’Europe est un héritage évident de la grande « guerre civile européenne » formalisée dans les institutions de la Guerre froide (dont procède l’Union Européenne elle-même), mais celle-ci recoupe d’une façon qui n’est pas aléatoire la division des deux types d’Empire constitués en Europe à l’âge classique (« continentaux » et « océaniques », dans la terminologie d’Hannah Arendt), et même, bien que de façon complexe, la trace des grands schismes politico-religieux du Moyen-Âge.
Mais d’autre part les nations – j’irai jusqu’à dire la forme nation typiquement européenne avant d’être exportée dans le monde entier – est elle-même indissociable du rapport aux empires qui par définition ont une dimension mondiale, excédant les limites géographiques et civilisationnelles du « continent Européen » quelle que soit la façon dont on essaye de les fixer. Ce qui est en réalité une tâche impossible, que ces nations se soient formées dans la réalisation d’un projet impérialiste ou qu’elles en aient été les produits de décomposition. L’effet en retour de sa longue histoire coloniale sur la constitution de l’Europe et sur la composition démographique ou culturelle de ses nations, non seulement n’est pas effaçable, mais n’est pas à proprement parler exogène. Tout ceci pour dire, même très schématiquement, que dans le cas de l’Europe (comme d’autres dans le monde, mais de façon singulière, peut-être constitutive de son « idée »), les frontières intérieures sont aussi des ouvertures externes, et plus généralement que la distinction entre intérieur et extérieur, entre le « soi » et le « monde », n’obéit pas à la logique de l’alternative. Aucune évolution interne de l’Europe ne sera jamais autre chose que l’envers d’une ou plusieurs modalités de relation avec son « extérieur », qui lui est toujours déjà immanent. En termes plus politiques, l’idée d’une indépendance ou autodétermination de l’Europe ne fait qu’un avec la question de savoir si elle dispose en tant que telle d’une capacité non seulement de se défendre et de se protéger mais d’infléchir les processus « cosmopolitiques » qui l’affectent déjà dans sa composition.
Revenons alors à la guerre d’Ukraine et à la mutation des systèmes d’alliances qu’elle est en train de précipiter. J’ai dit publiquement – et l’évolution des combats ne m’a pas fait changer d’avis, alors même que les souffrances et les destructions s’accumulaient pour les populations concernées – que l’Europe n’avait pas le choix de ne pas soutenir la résistance des Ukrainiens à l’invasion russe, à la fois contraire au droit international et nourrie d’une idéologie impérialiste particulièrement brutale. [3] Ce qui signifiait que l’Europe allait entrer dans la guerre elle-même, suivant des modalités évolutives. Ceci ne doit pas nous empêcher – bien au contraire – de prendre pleinement conscience des raisons pour lesquelles la guerre d’Ukraine est fondamentalement une guerre civile à deux niveaux, étroitement interdépendants. C’est une guerre civile européenne, ou plutôt un nouvel avatar de la grande guerre civile qui a déchiré l’Europe tout au long du 20ème siècle, parce que la Russie est une nation européenne (et même une nation dont la civilisation européenne a reçu des contributions essentielles) et parce que la configuration actuelle des antagonismes à l’Est du continent – y compris la question de savoir où passe le tracé entre démocraties et dictatures, entre intérieur et extérieur du projet fédéral – est pour une part le résultat de la façon dont l’URSS, qui était la réalisation d’un des grands projets politiques européens, s’est trouvée cantonnée et dévoyée dans les limites d’un ancien empire eurasiatique. C’est une guerre civile sur le territoire ukrainien lui-même, non parce que tout ou partie de la population de certaines régions s’identifierait à la Russie éternelle (comme le proclame Vladimir Poutine), mais parce que le multilinguisme et donc le multiculturalisme résultant d’une histoire complexe de colonisations et d’émancipations, y a rendu inextricables les héritages antagoniques. [4]
Mais d’autre part, si nous observons à la lumière des renversements stratégiques opérés par la nouvelle présidence américaine cette « guerre civile » élargie sur le temps long – au moins depuis l’écroulement du système soviétique et la brutale restructuration du régime politique, économique et social qui s’en est suivie dans son ancien espace – et si nous en récapitulons les épisodes du point de vue de leur place dans les rapports de forces mondiaux, je crois qu’il est difficile d’éviter deux conclusions. La première c’est que l’Empire américain (qui a lui-même bien entendu des origines et un caractère profondément « européen », au sens civilisationnel) n’a jamais été extérieur ni aux engagements stratégiques des pays européens ni même à la construction européenne en tant qu’ensemble politico-économique, bien que celle-ci soit marquée par un jeu complexe de dépendance et d’indépendance, voire de défi à l’égard du Grand Frère « occidental ». Le retournement d’alliances auquel correspond de facto la décision du président Trump de négocier avec la Russie en acceptant les termes dans lesquels celle-ci définit le conflit et en lui garantissant les acquisitions actuelles de son agression n’est peut-être pas stable, mais ce n’est pas non plus une lubie personnelle, comme on l’entend dire. Ce n’est pas justifier l’invasion russe que de replacer le soutien antérieur de l’OTAN à l’Ukraine dans le cadre du projet de containment et de roll back (au sens de Zbigniew Brzezinski) qui s’est déployé avant et après l’effondrement de l’URSS et qui a cherché à instrumentaliser les aspirations démocratiques des anciennes républiques soviétiques non-russes. Et ce n’est pas appliquer une grille idéologique « campiste » que de constater que les termes dans lesquels l’administration Trump impose aujourd’hui sa protection relative à l’Ukraine comportent une dose importante de colonialisme non dissimulé. Ce qui veut dire qu’en réalité les Etats-Unis ne se désengagent pas du continent européen, mais dans une sorte de nouveau partage de Yalta dont les Ukrainiens font les frais, cherchent à y maintenir leur influence dans une nouvelle géométrie et sous de nouvelles formes. Dans le même sens vont évidemment les ingérences américaines dans la vie politique des Etats européens, au profit de forces néofascistes.
Tout ceci signifie, on l’aura compris, que je considère avec d’autres que l’Union européenne a bel et bien affaire aujourd’hui dans sa quête ou son besoin d’indépendance à deux impérialismes tantôt en guerre, tantôt en négociation, par rapport auxquels il lui faut se situer. Son avenir en dépend. Je ne les mets pas sur le même plan du point de vue des dangers qu’ils représentent (mais je peux dire ceci parce que je parle en Européen depuis l’Europe, il est évident que je ne pourrais tenir le même langage si j’étais Irakien, ou a fortiori Palestinien). Il existe un expansionnisme russe dont l’Europe est la cible potentielle, mais partielle. Je ne crois pas que, nouveau Napoléon ou nouvel Hitler, Poutine ait le projet d’envahir le continent en ne s’arrêtant qu’à Vienne, à Berlin ou à Paris. Mais je crois que l’idéologie de la Grande Russie dont Poutine est l’héritier et que les idéologues du régime ont combinée avec un discours racialiste et mystique implique des visées sur toutes les nations de « l’étranger proche » qui ont autrefois fait partie de l’empire des tsars. Et donc que l’Europe a besoin de pouvoir les défendre et se défendre de ce danger, ce qui implique de mieux s’armer ou de s’armer autrement. Cela implique aussi de développer une critique radicale de la façon dont l’influence et les aides financières de la Russie irriguent toute une partie des extrêmes droites européennes. De l’autre côté je ne crois pas que l’impérialisme américain représente un danger symétrique (encore que l’affaire groenlandaise révèle l’existence de visées expansionnistes qui visent aussi le territoire européen, en exploitant son incomplète décolonisation). Mais je crois que la question latente depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de savoir quel intérêt la communauté des nations européennes a à s’identifier avec un « camp occidental » dont la définition est élaborée en Amérique doit revenir au premier plan pour enfin recevoir, si possible, une réponse qui soit « eurocentrique », ou plutôt qui prenne comme fil directeur l’articulation des intérêts de l’Europe avec ceux du reste du monde, indépendamment de l’assignation à un « camp ». Je me place donc délibérément dans la voie qui fut celle de dirigeants comme Willy Brandt ou Gorbatchev au déclin de la Guerre froide, en me posant la question de savoir comment on pourrait en actualiser l’inspiration. [5]
*
Mais comme je le disais à l’instant, il me semble impossible d’enfermer la question de la place de l’Europe dans le monde (et de la place que les évolutions du monde lui assignent) dans ces considérations géopolitiques, si brûlantes soient-elles. J’en ajouterai qui sont de deux autres ordres, et différentes entre elles.
Il faut distinguer de la question géopolitique au sens qui vient d’être évoqué une question géoéconomique qui concerne les transformations de la mondialisation et les restructuration du capitalisme contemporain. Ai-je besoin de préciser que je ne suis pas économiste et que mes hypothèses sur ce point sont fragiles à mes propres yeux ? Je réfléchis tout en essayant d’apprendre. Deux idées ont cours, que les développements récents de la « guerre commerciale » lancée par les Etats-Unis tendent à accréditer. La première c’est que l’ère du néo-libéralisme triomphant, fondé sur l’intensification de la division internationale du travail, donc la dissémination des « chaînes de valeur » et la montée en puissance d’un capitalisme transfrontière qui confère une fonction hégémonique aux « opérations logistiques » de circulation des marchandises (Mezzadra et Neilson) se sont heurtées à une réaction nationaliste et néo-mercantiliste. [6] La seconde c’est que l’impérialisme montant et aspirant à l’hégémonie mondiale à la place de l’Empire américain sur le double plan économique et politique est la Chine, devenue la plus grande puissance industrielle du monde et, dans toute une série de domaines (y compris celui des « énergies renouvelables »), son avant-garde technologique.
Quelles seraient pour l’Union Européenne, en tant qu’elle se conçoit d’abord comme une construction économique pariant sur le libre-échange, les conséquences de ces mutations ? Il me semble qu’on peut proposer ici deux remarques. Premièrement la notion d’impérialisme, si utile qu’elle soit pour corriger les visions idéales de l’économie-monde comme un espace de libre concurrence dégagé des rapports de forces et des inégalités de développement, a l’inconvénient de rabattre l’une sur l’autre les questions géopolitiques et les questions géoéconomiques qui correspondent à des évolutions temporelles et à des « géométries » (comme disait Giovanni Arrighi) ou à des « partages du monde » (comme disait Lénine) de nature différente. [7] Elles interfèrent, c’est certain, mais ne procèdent pas d’une causalité unique. C’est pourquoi, vue d’Europe, la question du rapport de forces entre les Empires russe et américain et celle de la concurrence entre les capitalismes américain et chinois posent des problèmes complétement différents, qu’un raisonnement en termes de « camps » tend à brouiller.
Les Européens ne se situent pas « entre » la Chine et les Etats-Unis de la même façon qu’il se trouvent « entre » les Etats-Unis et la Russie, qui est une puissance militaire et territoriale déterminante, mais représente aujourd’hui un facteur négligeable dans l’évolution de l’économie-monde. Deuxièmement, la concurrence des capitalismes américain et chinois, dont chacun est étayé par un puissant « étatisme économique », même si c’est sous deux formes idéologiquement antithétiques, n’est peut-être pas principalement, et contrairement aux scénarios interprétatifs d’historiens économiques d’inspiration braudélienne, celle de l’ancien et du nouveau hégémon mondial (comme le furent naguère celle des Pays-Bas et de l’Angleterre, ou de celle-ci et des Etats-Unis, sans oublier les aspirants à jouer le rôle de troisième larron, comme l’Allemagne au 19ème siècle et le Japon au 20ème). [8] Il s’agirait plutôt d’une complémentarité conflictuelle (si je peux risquer cet oxymore) entre deux aspects et deux tendances de développement du capitalisme contemporain : d’un côté le productivisme industriel dont la Chine, nouvel « atelier du monde » et fer de lance d’une nouvelle révolution industrielle, est devenue le centre mondial ; de l’autre l’empire bancaire et plus généralement la domination du marché de la circulation des capitaux et des services financiers dont les Etats-Unis n’ont pas le monopole, certes, mais dont, grâce à la conservation de la monnaie dominante, ils continuent de bénéficier. L’Europe n’exerce aucune de ces deux dominations, mais cherche avec difficulté à ne pas se transformer simplement en marché de consommateurs et débiteur d’emprunts internationaux. [9]
Il est vrai que cette présentation dichotomique peut être pertinente pour comprendre les termes dans lesquels se présentent en ce moment les batailles douanières et réglementaires à l’échelle mondiale. Mais son inconvénient principal est de négliger le sens et les effets de la révolution informatique des instruments de communication et de l’intelligence artificielle, puisque celle-ci, à travers ce que Thomas Berns et Antoinette Rouvroy ont appelé la « gouvernementalité algorithmique », [10] est en train, non seulement d’opérer une véritable « colonisation des rapports sociaux », depuis les modes de consommation et l’organisation de la vie quotidienne, mais de bouleverser l’articulation même des opérations de production, de circulation et de financement, en installant au poste de commandement des « plateformes » qui se déploient dans un espace virtuel. Elle fait partie de ce que, en d’autres lieux, j’ai tenté d’appeler un « capitalisme absolu » [11] incorporant à son régime d’accumulation la totalité ou quasi-totalité des activités humaines, et qui relativise le conflit entre les deux versants traditionnels du capitalisme incarnés par la Chine et les Etats-Unis, ou plutôt devient le véritable enjeu de leur rivalité. [12] J’ai cru comprendre que le rapport Draghi présenté en novembre dernier avait pour enjeu de savoir comment l’Europe, en tant que communauté économique intégrée, peut éviter de décliner et de se décomposer dans la nouvelle mondialisation, mais il faudrait aussi se demander si elle peut proposer – et se proposer à elle-même – une voie originale dans la mutation technologique, c’est-à-dire développer un capitalisme original, ou peut-être (c’est moins évident) une forme originale de compromis avec le capitalisme. [13] Mais une telle question – qui n’a toujours pas fait l’objet d’un véritable débat à l’échelle des opinions publiques et des sociétés européennes – n’a de sens que si on introduit la considération d’une troisième forme d’environnement mondial, peut-être la plus décisive de toutes en termes de civilisation, je veux dire celle de l’environnement « planétaire » ou « terrestre ».
En effet le mot d’environnement ici change de sens. Bien qu’à l’évidence la catastrophe climatique et biologique en cours ait des dimensions géographiques très importantes, parce que la terre est divisée en zones hétérogènes qui ne subissent pas de la même façon les effets du réchauffement ou des politiques extractivistes qui affectent la biodiversité et les conditions de vie des communautés humaines, et ne contribuent pas également à ce que l’écrivain indien Amitav Ghosh a appelé le « grand dérangement », [14] il y a une différences fondamentale entre un schème de confrontation entre des puissances continentales plus ou moins agressives équipées d’armes de destruction massive, ou même un schème de répartition des ressources économiques et des circulations de capitaux, et une topographie des processus qui contribuent à la transformation de l’habitat terrestre. On retrouve ici, mais dans une dimension beaucoup plus matérielle, la question de l’insuffisance des distinctions mécaniques entre l’intérieur et l’extérieur des frontières, qui hantait déjà la prise en compte des effets de la révolution informatique comme superposition à la géographie des nations d’une sphère virtuelle qui les relativise. Il n’est pas nécessaire de franchir les frontières politiques et économiques pour que les conséquences de la surconsommation ou de la surproduction de biens industriels (y compris ceux de l’industrie agricole) affectent les conditions et les chances de vie des humains de l’autre bout du monde. Toute reproduction d’une communauté humaine et politique obéissant à un certain genre de vie ou l’érigeant en objectif de son développement historique est donc toujours à la fois cause et effet des conséquences qu’elle entraîne sur l’environnement planétaire dont elle fait partie et qui la pénètre, mais aussi la déborde et implique son intersection avec d’autres communautés, voire d’autres civilisations.
Plus précisément et plus cosmopolitiquement on peut souligner l’importance de trois « contradictions » – au sens que la tradition dialectique donnait à ce terme – qui marquent d’incertitude la place que les populations européennes occupent dans la crise environnementale et du rôle qu’elles pourraient jouer dans sa résolution. Il y a d’abord le fait, déjà signalé, que les catastrophes dues au réchauffement climatique ou indirectement liées à la dégradation de l’environnement (comme on l’a vu pour la pandémie du Covid-19), même si elles peuvent surgir en tout point de la planète (songeons aux incendies californiens ou aux inondations espagnoles) n’en affectent pas moins de façon beaucoup plus destructrice et irréversible les zones continentales de sous-développement et de grande pauvreté, ce qui contribue non pas à l’émergence de politiques de solidarité mais au creusement des différences raciales ou racialisées au sein de l’espèce humaine. [15] Il y a ensuite le fait (sur lequel insiste très pertinemment Amitav Ghosh) que la décolonisation et la croissance économique des pays du « Sud global » en quête d’égalité avec les anciens colonisateurs produit une accumulation négative en matière de destruction de l’environnement : les pays du Nord, dont l’Europe, sont toujours les plus grands consommateurs de produits carbonés ou incorporant des composants dont l’extraction dévaste l’environnement, mais les pays du Sud en sont les plus grands producteurs, soit pour satisfaire les besoins du Nord, soit pour accélérer leur propre rattrapage. Enfin il y a le fait – lourd de conséquences pour la vie politique des démocraties libérales et profondément impliqué dans la genèse de ce qu’on appelle les « populismes » – qu’il n’existe aucun programme économique ou principe de planification applicable dans l’état actuel des rapports de forces sociales et politiques, en Europe notamment, qui concilierait la conservation d’un niveau de vie supportable par la masse de la population avec une décroissance ou une désindustrialisation rationnelle, sans laquelle les effets d’inhabitabilité de la planète deviendront irréversibles.
Ces « contradictions » sont l’horizon dans lequel se présente la question d’une politique européenne qui soit non seulement une façon d’en faire coexister les populations avec leurs spécificités historiques, mais une façon de leur dessiner un avenir commun, dont la mise en œuvre du projet fédéral est la condition de possibilité. Elles n’annulent pas l’importance et l’urgence des questions géopolitiques et géoéconomiques, mais elles en surdéterminent complétement la signification, parce qu’elles sont à la fois plus urgentes et de plus longue portée, ce qui rend d’autant plus étonnant (ou au contraire trop compréhensible) que, malgré de périodiques déclarations d’intention, elles soient constamment marginalisées et euphémisées. Mais leur affrontement et leur mise en discussion suppose aussi – il faut bien en prendre la mesure – une révolution ou une conversion dans notre façon de comprendre les idées de puissance et d’indépendance. A l’aune des contradictions écologiques, le maximum d’indépendance c’est aussi le maximum d’interdépendance, ou c’est une façon d’élaborer l’interdépendance, et non pas de la neutraliser. Et surtout l’équivalence traditionnelle entre les idées de pouvoir et de puissance doit être remise en question, comme le suggèrent depuis des années des philosophes inspirés par la lecture de l’œuvre de Spinoza. [16] Entendue dialectiquement comme non-impuissance, ou sortie de l’impuissance, c’est-à-dire de l’incapacité à influer sur les conditions, tant internes qu’externes, qui déterminent nos modes de vie et retreignent notre liberté, la puissance ne peut pas s’identifier au pouvoir, c’est-à-dire à la capacité de subjuguer nos ennemis ou nos adversaires en leur imposant un rapport de forces aussi unilatéral que possible, en faisant plier leur « volonté », il faut qu’elle corresponde au contraire avec une capacité maximale d’être affecté par d’autres que soi, c’est-à-dire d’accueillir leur présence ou leur influence, ou de négocier leurs exigences de façon à les rendre compatibles avec notre autoconservation.
Traduit à nouveau en termes politiques, cela veut dire que l’Europe ne doit ni oublier ou récuser la trace de l’expansion impériale (en particulier coloniale) qui lui a permis de se structurer en nations au détriment du monde entier, ni se murer dans un isolement fictif dont ne s’évaderaient que les transactions financières, mais transformer le sens et les modalités de cette dépendance, en faisant de la communication avec le reste du monde (ou avec le plus grand nombre possible de « mondes » dans l’horizon planétaire) le fondement de sa propre affirmation. Et donc, si je me suis bien exprimé, en faisant de la crise environnementale l’urgence des urgences, fixant une orientation pour le traitement de toutes les autres, si pressantes qu’elles apparaissent, qu’il s’agisse de la guerre et de la paix, ou de la compétitivité et de la croissance.
*
J’en arrive alors, bien tard et de ce fait bien incomplètement, à la question de la fédération, c’est-à-dire aux usages et aux alternatives que recouvre ce terme pour nous aujourd’hui. Je prendrai pour point de départ une proposition récemment formulée par le célèbre historien britannique Timothy Garton Ash (europhile convaincu) qui, comme plusieurs d’entre nous sans doute, m’a à la fois frappé et laissé perplexe. Soulevant un problème incontournable, elle en propose en même temps une solution qui semble plutôt reproduire la difficulté. Décrivant en juillet 2023 dans Le Grand Continent [17] la renaissance du projet impérial russe et son extension possible à des régions entières de l’Europe orientale, tout en admettant sans détour que cette renaissance était pour une part la réponse à ce qu’il appelait « l’élargissement de l’Occident géopolitique » après l’effondrement de l’URSS, dont faisaient partie les expansions simultanées ou décalées de l’Union européenne et de l’OTAN, Timothy Garton Ash expliquait que l’Union européenne ne pourrait s’en défendre qu’en acquérant elle-même une dimension impériale, c’est-à-dire armée ou militarisée, et centralisée au point de vue de sa capacité de décision, bien que « sans hégémonie » entre ses nations ou nationalités constituantes (comme c’était le cas dans les empires traditionnels) ni restriction autoritariste de sa démocratie interne. D’où la référence à cet « empire libéral » qu’auraient incarné historiquement les Etats-Unis d’Amérique, et le recours à des formules oxymoriques comme « empire post-impérial » ou « empire anti-impérial ». En somme dans le monde des empires (et des impérialismes), ne peuvent subsister que des empires, mais il faudrait que l’Europe en incarne la version la plus inoffensive.
Ce paradoxe ne m’a pas paru tenable, mais je me suis souvenu alors d’un remarquable développement de Raymond Aron, datant maintenant d’il y a plus de 60 ans, dans la section finale de son livre de 1962 : Paix et guerre entre les nations, où il écrit que les nations se trouvent désormais placées devant le choix ou d’adhérer à une fédération (potentiellement universelle, ou du moins ouverte à de nouvelles adhésions) ou de se trouver incorporées à un empire à prétention mondiale (tel que le dessinaient les camps de la Guerre Froide). [18] Ce dilemme est frappant parce qu’il présuppose (ce que tout le monde n’admettra pas) que l’ère des souverainetés nationales absolues (ou de leur apparence) est révolue, mais que les modalités de leur disparition, ou plutôt de leur transformation en une nouvelle forme ou « formation » historique, sont ouvertes à plusieurs possibilités. Des possibilités qui sont peut-être inégalement nécessaires, mais aussi inégalement souhaitables du point de vue d’une philosophie politique libérale ou démocratique. Il suggère aussi de reprendre la question de la fédération non pas, comme ont tendance à le faire les juristes, sous l’angle de la souveraineté des Etats et de sa restriction ou de son partage, mais sous l’angle des différents modes d’existence et de configuration des nations selon qu’elles se représentent comme des absolus autosuffisants et indépassables, ou au contraire comme composantes et parties prenantes d’ensembles plus complexes et plus hétérogènes, mais n’en possédant pas moins un principe d’unité ou un intérêt commun qui doit se traduire politiquement, constitutionnellement. Ou si l’on veut, il suggère de considérer la question de la perpétuation ou du déclin des Etats-nations non pas exclusivement du point de vue des institutions étatiques, mais du point de vue de ce que j’avais appelé plus haut la « forme nation ». [19] Or il me semble que c’est précisément l’attachement à cette forme, du point de vue de ses fonctions imaginaires autant que sociales, qui est au cœur des antagonismes aujourd’hui observables entre les peuples européens et en leur propre sein, dont j’évoquais pour commencer les effets potentiellement dévastateurs sur l’unité politique et la constitution démocratique de l’Europe.
On ne peut avancer dans cette voie, cependant, que si on introduit dans la formulation même du problème un élément tout aussi politique que celui de la souveraineté et de sa délégation à des instances de gouvernement supranationales, mais plus directement lié aux mécanismes sociaux de reproduction ou de désagrégation de la cohésion nationale. C’est ce que je voudrais faire ici en invoquant, à côté et en complément du « théorème d’Aron », qui situe le devenir de l’Etat nation, de façon au moins potentielle, entre un devenir fédératif et un devenir impérial (ce qui suppose aussi, contrairement à la thèse de Garton Ash, qu’il puisse exister des fédérations comme pôles de résistance et modèles d’évolution dans le monde des empires), ce que j’appellerai par symétrie le « théorème de Milward ». Je me réfère ici, vous vous en doutez, à l’œuvre de l’historien britannique Alan Milward (souvent invoquée à l’appui des critiques de ce qu’un certain nationalisme méthodologique appelle « l’utopie fédéraliste »), mais en en faisant en quelque sorte usage à rebours. [20] Dans son livre de 1992, The European Rescue of the Nation-State, Milward, on s’en souvient, avait défendu la thèse paradoxale suivant laquelle – par une sorte de ruse de la raison politique – la construction progressive de la Communauté, puis de l’Union Européenne, bien que transférant à une autorité supranationale des pouvoirs de plus en plus importants (surtout économiques, mais dans une société moderne l’économique n’est pas séparable du politique), n’avait pas affaibli ou relativisé les indépendances nationales, mais au contraire prévenu leur déclin et finalement « sauvé » les nations européennes de la dissolution dans les affrontements de l’après-guerre.
Une version provocante et discutable de l’argument veut que d’emblée le soi-disant fédéralisme européen n’ait pas eu d’autre objectif implicite que la construction de ce que le Général de Gaulle avait appelé « l’Europe des patries », et dont se réclament à nouveau aujourd’hui un certain nombre de souverainistes en Europe (dans une version évidemment plus sinistre). Les institutions fédérales auraient donc été pour une part une fiction, pour une part le substitut d’une capacité d’autodéfense devenue trop faible ou contradictoire avec l’indépendance réelle dans le monde actuel. Mais une version plus intéressante à mes yeux consiste à relier les effets politiques de la construction européenne avec le développement du Welfare State et de ce que, en d’autres lieux, j’avais appelé « l’Etat national social ». [21] Car les nations sont certainement des formations historiques d’une extraordinaire résistance au changement, possédant de profondes racines linguistiques, culturelles et imaginaires, mais elles ne sont pas pour autant éternelles, immunisées contre les effets désagrégateur des chocs externes (par exemple des guerres d’extermination) et la violences des conflits internes (engendrées, suivant les cas, par le conflit de classes ou par ce que Spinoza appelait les « haines théologiques », voire leur superposition). Comme toute « formation » sociale et historique, la nation a besoin d’être reproduite, ce qui veut dire aussi périodiquement refondée sur de nouvelles bases. Ma thèse de longue date (qui n’est pas originale, sauf peut-être du point de vue de la terminologie) a été que la forme nation en Europe a été reproduite et consolidée, donc relégitimée aux yeux de ses propres citoyens, et notamment de « ceux d’en bas » : les travailleurs exploités, par la mise en place de l’Etat national-social (comme alternative historique à l’Etat totalitaire, « national-socialiste » en même temps qu’au « libéralisme » économique pur), c’est-à-dire un Etat qui constitutionnalise les droits du travail et la « sécurité sociale » dans un cadre national plus ou moins restrictif (pour ce qui est notamment des droits des étrangers), et inversement refonde l’idée de solidarité ou de communauté des citoyens en caractérisant ceux-ci, malgré la très grande diversité de leurs occupations et de leurs conditions, comme des « citoyens actifs » ou des « travailleurs ». [22] Mais ce que le théorème (ou l’argument) de Milward ajoute à cette hypothèse c’est que, historiquement, dans le cadre européen, le processus de développement de l’Etat national-social n’a pas été purement autarcique, et ne s’est pas déroulé dans chaque cadre national indépendamment de l’environnement supranational, comme si les Etats ne faisaient pas partie d’un ensemble ou d’une « région » économiquement unifiée. C’est aussi la construction européenne qui en a favorisé et garanti la pérennité dans chaque Etat membre en particulier et dans sa variante propre.
Une telle formulation permet alors de comprendre quand et comment ce qui constituait une garantie pour la forme nation a cessé de l’être et même a commencé à fonctionner en sens inverse, comme un facteur de désagrégation et de crise. Le tournant, pour le dire très brutalement, c’est le moment où la Commission Delors (soutenue par ses mandataires nationaux) renonce à développer sur le plan normatif et celui des politiques économiques un « Etat social européen », ou à l’échelle européenne, ce qu’on pourrait appeler un « Etat fédéral-social ». C’est-à-dire le moment où, dans le contexte de généralisation des politiques néo-libérales que formalisera le « consensus de Washington », la monnaie commune est mise en place pour favoriser l’intégration et la compétitivité des capitalismes européens sans que, symétriquement, le « compromis social » institutionnalisant les acquis de la lutte des classes et ouvrant la possibilité d’une réduction, même décalée, des écarts de richesse et de pouvoir entre le capital et le travail, soit transposé à l’échelon communautaire. [23] On change de système de gouvernement, mais on change aussi de capitalisme, et les deux processus sont indissociables. Dès lors, les institutions « de Bruxelles » ou « de Francfort » sont perçues et fonctionnent réellement comme le moyen d’externaliser les décisions qui influent sur les rapports de travail et sur les conditions sociales, ou comme un moyen de les soustraire à la contestation populaire. Et c’est ce qui se poursuit aujourd’hui. L’Union européenne encourage alors les Etats non pas à développer de nouvelles formes de sécurité sociale adaptées au capitalisme mondialisé, mais à démanteler les anciennes malgré les résistances systématiquement dénigrées comme « corporatives ». Les inégalités de revenu atteignent des proportions astronomiques comme dans le reste du monde, en même temps que se développent les formes de précarité que Robert Castel a désignées comme « désaffiliation » ou « insécurité sociale ». [24] De cette situation les souverainistes de gauche comme Wolfgang Streeck tirent la conclusion que les droits du travail ne peuvent, en quelque sorte par nature, être protégés que dans un cadre national, ce qui efface l’histoire du rapport de forces qui a traversé la construction européenne et donne pour une caractéristique d’essence ce qui a résulté d’un choix politique. La porte est ouverte à l’alternative entre l’empire et le populisme nationaliste, deux modalités de dégénérescence de la démocratie. [25]
*
Sans doute cet exposé est déjà beaucoup trop long sans avoir pour autant réussi à complètement élucider les questions que j’ai voulu soulever. S’il me reste encore un peu de temps, je voudrais pour ouvrir la discussion formuler trois conséquences de ce qui précède qui ne se présenteront que comme des questions ouvertes.
La première c’est qu’on ne peut pas construire une fédération par en haut. Plus précisément on ne peut pas la construire par le simple transfert à une autorité « fédérale » ou « communautaire » – même sous une forme partielle et progressive – de ce que la tradition de la philosophie politique, depuis Bodin et Hobbes, avait appelé les « marques de la souveraineté ». Ou plus exactement on ne peut pas éviter l’autodestruction de la fédération si ce transfert a lieu sans que se constitue en contrepartie, « par en bas », une puissance collective démocratique de généralité équivalente. C’est ce qui a eu lieu successivement avec l’institution de la monnaie commune, l’attribution à la Commission européenne du pouvoir de négocier et conclure les traités commerciaux, le contrôle des frontières et la répression des flux migratoires dans les règlements de Schengen et de Dublin, et ce qui aura lieu demain avec la capacité de défense si la conjoncture internationale et l’argument géopolitique enjoignant de faire face aux empires par des moyens équivalents poussent à la construction effective d’une armée européenne avec des contingents nationaux. Naturellement il y a derrière ces initiatives des intérêts matériels et pas seulement idéologiques, par exemple la substitution d’une industrie d’armements aux capacités exportatrices défaillantes de l’industrie automobile…
Le résultat est ce que Habermas avait appelé d’une terrible formule le postdemokratischer Exekutivföderalismus, et que mon ami le juriste Carlos Herrera a désigné comme un « étatisme de marché ». [26] De mon côté j’avais parlé d’une pseudo-fédération, qui n’est pas une étape vers la réalisation d’une fédération, mais une perversion de son idée et un obstacle devant son acceptation par les citoyens nationaux. [27]
La deuxième conséquence, c’est que si l’on admet avec de très grand politologues (depuis Carl Joachim Friedrich jusqu’à Robert Schütze) [28] et des juristes comme Olivier Beaud que la distinction « classique » entre fédération et confédération est une question de degré et de convention, suivant qu’on observe le rapport des unités nationales et supranationales dans le sens de la composition de l’unité ou de la décomposition vers la multiplicité, l’essentiel réside dans le sens du processus de transformation des indépendances nationales, autrement dit dans leur mouvement de fédéralisation plus ou moins avancé suivant les besoins de la conjoncture historique plutôt que dans la forme constitutionnelle où il se cristallise. Si l’on combine cette remarque avec la proposition précédente, suivant laquelle un « fédéralisme d’en haut », qui ne s’accompagne d’aucun accroissement des puissances du « bas » (c’est-à-dire des citoyens eux-mêmes) à l’échelle transnationale, travaille à l’exact opposé de l’objectif proclamé, il apparaît que les processus de fédéralisation et de démocratisation sont en réalité indissociables. La démocratisation n’est pas une caractéristique accidentelle ou complémentaire qui peut survenir à une fédération existant sans elle, puisque sans démocratisation il n’y a pas de fédéralisation, ou la fédération s’autodétruit.
Mais qu’est-ce qu’une démocratisation transnationale ? Cette question ne peut pas être réglée dans le cadre de l’interminable polémique sur les pouvoirs respectifs des instances communautaires et des Etats-nations (ou des nations représentées par leurs Etats), qui engendre le conflit stéréotypé du supranationalisme (qui est aussi bien « l’Empire post-impérial ») et des nationalismes qui invoquent la « souveraineté populaire » comme un paradis perdu. Elle ne peut pas l’être non plus par l’institution formelle d’une citoyenneté fédérale ou européenne commune, indifférenciée, même assortie d’un droit de vote plus ou moins déterritorialisé. La discussion sur l’existence et l’inexistence du « demos européen » est concluante sur ce point, mais par la négative. [29] Cependant elle ne clôt pas, elle ouvre plutôt la réflexion sur les voies de la démocratisation. Kalypso Nicolaidis avait fait progresser cette réflexion de façon intéressante en forgeant le néologisme de « démoï-cratie », c’est-à-dire en essayant d’inscrire le pluralisme historique des nations européennes dans leur conception même de la souveraineté populaire. [30] Mais ce faisant elle n’a pas dénoué l’équivoque qui travaille les deux significations de l’idée de « peuple » et qui s’exprime périodiquement, tantôt de façon libératrice, tantôt de façon réactionnaire ou régressive (comme dans le passage du slogan Wir sind das Volk au slogan Wir sind ein Volk au cours de la révolution allemande de 1989). Elle l’aurait plutôt reconduite. Je n’ai évidemment pas de solution toute faite, mais sur la base de ce que j’esquissais plus haut à propos de l’Etat social et de sa contribution à la reproduction de la forme nation, je serais tenté de dire que la clé du mouvement « d’en bas » pour une fédération démocratique en Europe réside dans la possibilité d’instaurer un échange, une confrontation, un conflit, voire une dialectique entre les deux sens du mot peuple, das Volk et ein Volk (donc aussi plusieurs Völker), c’est-à-dire plusieurs histoires, plusieurs cultures, plusieurs langues, non pas dans le cadre préétabli des souverainetés étatiques, mais dans un espace transnational ouvert qui soit potentiellement commun. C’est-à-dire de construire un débat paneuropéen entre les citoyens eux-mêmes (à travers leurs partis, leurs mouvements, leurs intellectuels et leurs artistes) sur l’importance respective et l’intersection de leurs intérêts de classe, de genre, de race ou d’ethnicité et de culture et sur la façon de les composer.
Naturellement c’est plus facile à dire qu’à faire, ou plus exactement c’est une proposition circulaire : sa mise en œuvre suppose d’une certaine façon que le résultat, c’est-à-dire la transgression des frontières ou leur changement de statut, ait été déjà acquis. Reste à espérer, non seulement que le besoin suggère des expédients, des initiatives, mais surtout que des mouvements collectifs soient d’ores et déjà situés, par leurs objectifs mêmes, en dehors du cercle. Un de ceux dont, pendant des années, j’aurais supposé que, potentiellement planétaire par son objet même, il devait du même coup se construire d’emblée à travers les frontières nationales de l’Europe, de façon fédérale ou quasi-fédérale, c’était le mouvement écologique de la jeunesse pour la défense de la Terre ; mais ce n’est toujours pas le cas, ou si peu…
Surtout – et c’est mon tout dernier point – la conversation « d’en bas » entre les intérêts sociaux et les formes de citoyenneté suppose un canal de communication, des instruments et un idiome commun. La sphère publique des démocraties libérales s’est construite, comme on sait, au moyen de la littérature, du journalisme, de l’école, des partis politiques, mais aussi des contre-cultures ouvrières dans un cadre national. [31] La question rédhibitoire posée aux tenants de la fédération européenne comme construction démocratique (Régis Debray me l’avait un jour ironiquement opposée) a toujours été : « dans quelle langue ces citoyens d’Europe communiquent-ils entre eux ? » A quoi Umberto Eco avait répondu dans une belle formule toujours citée (mais d’origine introuvable) : « la langue de l’Europe c’est la traduction ». [32] Et il est vrai que la traduction est une pratique populaire aussi bien que savante. Mais elle décline dramatiquement en Europe comme ailleurs. Au cours de quarante ans d’adhésion au « parti de l’Europe », dans la trace du Manifesto di Ventotene rédigé en 1941 par Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, j’ai longtemps cru que l’intensification des échanges matériels et culturels, de la circulation des personnes, et même des conflits entre les citoyens des différentes nations du continent, avec toutes ses inégalités et ses difficultés, ferait émerger un « espace civique » commun et pousserait à l’inter-traduction des langues. Le contraire s’est produit, sauf pour une toute petite couche d’intellectuels cosmopolites et, ne l’oublions pas, pour une masse certes importante mais socialement disqualifiée et ségrégée de travailleurs immigrés, d’origine intra- et extra-européenne. La cause n’en est pas seulement dans la montée des nationalismes, dans le déclin de l’internationalisme, ou plutôt celui-ci est un effet autant qu’une cause. La cause fondamentale, c’est le remplacement de la conversation par l’usage des réseaux sociaux, et surtout, désormais, la généralisation de la traduction automatique, qui rend inutile toute « épreuve de la traduction » (Antoine Berman), et donc en supprime à la fois le besoin et les agents. Quels sont les mouvements qui, en Europe aujourd’hui comme ailleurs dans le monde, sont susceptibles de résister à cette colonisation ou de lui trouver des antidotes ? Je n’en sais rien mais je ne suis sans doute pas placé au bon endroit pour juger. Je dois me contenter à nouveau de pointer l’aporie, ou l’impossible possibilité.
[1] Yves Mény : « L’union européenne et le fédéralisme : impossible ou inévitable ? », Politique européenne, n° 53, 2016/3, Le fédéralisme européen.
[2] Etienne Balibar, Europe, crise et fin ?, Editions Le Bord de l’eau, 2016.
[3] Etienne Balibar : « Le pacifisme n’est pas une option », Mediapart, 7 mars 2022.
[4] Voir la très intéressante enquête de Daria Saburova : Travailleuses de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre, Editions du Croquant 2024.
[5] Voir l’essai de Peter Brandt : Mit anderen Augen: Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt, Dietz Verlag Berlin 2013. Et Sophie Momzikoff, « Aux origines de la Maison commune européenne de Gorbatchev : influences et concepteurs (années 1970-1989) », Histoire Politique, 46 | 2022.
[6] Sandro Mezzadra and Brett Neilson : The Politics of Operations: Excavating Contemporary Capitalism, Duke University Press 2019.
[7] Voir E. Balibar : “Géométries de l’impérialisme au XXIème siècle », AOC Media, 25 et 26 novembre 2024.
[8] Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin. Les promesses de la voie chinoise, Ed. Max Milo, 2009.
[9] Voir Michel Aglietta, Zone euro. Éclatement ou fédération, Paris, Michalon, 2012.
[10] A. Rouvroy etT. Berns : « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », in Politique des algorithmes. Les métriques du web, Réseaux 2013/1 n° 177 La Découverte.
[11] E. Balibar : « Absolute Capitalism », in W. Callison and Z. Manfredi : Mutant Neoliberalism. Market Rule and Political Rupture, Fordham University Press, 2020.
[12] Voir par exemple Pierre Veltz : La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif, Editions du Seuil 2017.
[13] The future of European competitiveness: Report by Mario Draghi, European Commission, https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en
[14] Amitav Ghosh, Le grand dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique, Wildproject 2021.
[15] Le directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé, le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait parlé à ce sujet d’un « apartheid vaccinal ». Voir mon commentaire : « Un monde, une santé, une espèce. Pandémie et cosmopolitique », in E. Balibar, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, Editions La découverte, 2022.
[16] Voir l’œuvre d’Antonio Negri, en particulier : Le pouvoir constituant : essai sur les alternatives de la modernité, Paris, Presses Universitaires de France, 1997.
[17] Timothy Garton Ash : « L’Union comme empire post-impérial », Le Grand Continent, 20 juillet 2023.
[18] Raymond Aron : Paix et guerre entre les nations (1962), Huitième édition avec une présentation inédite de l’auteur, Calmann-Lévy, 1984. Olivier Beaud s’y réfère dans sa Théorie de la fédération, Presses universitaires de France, collection Léviathan, 2007 (p. 68 sv.).
[19] J’avais esquissé une théorie de cette « forme » dans mes contributions au livre écrit avec Immanuel Wallerstein : Race, nation, classe. Les identités ambiguës, nouvelle édition augmentée, Editions La Découverte, 2018.
[20] Alan S. Milward : The European Rescue of the Nation-State, Routledge 1992. Une utilisation significative de l’argument de Milward dans un sens anti-fédéraliste figure dans le livre de Perry Anderson, The New Old World, Verso 2009.
[21] Etienne Balibar : Les Frontières de la démocratie, La Découverte 1992 ; La Proposition de l’égaliberté, Presses Universitaires de France 2010. Une discussion approfondie du rapport conflictuel que l’Etat national-social entretient avec le processus de la mondialisation néo-libérale, se référant généreusement à mes formulations et les élargissant considérablement, figure dans l’ouvrage d’Edouard Delruelle : Philosophie de l’Etat social. Civilité et dissensus au XXIe siècle, Editions Kimé 2020.
[22] Ceci vaut autant à l’Ouest qu’à l’Est de la division des blocs, bien que selon des modalités tout à fait différentes dont il faudrait discuter en détail. Le démantèlement des structures de sécurité sociale héritées du « socialisme réel » dans le moment même où celles du « modèle européen » social-démocrate étaient remises en question à l’Ouest, est une des causes fondamentales de la montée du « populisme », notamment en Allemagne.
[23] Dans une correspondance suivant mon exposé, Justine Lacroix m’objecte ceci : « Vous avez incriminé la Commission Delors pour avoir fait primer le marché unique sur la construction d’une Europe sociale puis la monnaie unique sur la politique économique. Mais, Delors n’avait pas de majorité au Conseil pour faire l’Europe sociale et mettre en place une politique économique. Avant de lancer le marché intérieur, il avait fait un tour des capitales pour proposer l’Europe sociale et il s’est heurté à un mur (…) Delors n’était pas un révolutionnaire, sans doute, mais il ne se confond pas avec Lamy. » Je lui donne acte de cette correction, qui revient à ne pas confondre le résultat avec les intentions. Mais il reste à savoir pourquoi Delors s’est enfermé dans ce rapport de forces… On trouvera d’utiles analyses à cet égard dans le livre de Robert Salais, Le viol d’Europe. Enquête sur la disparition d’une idée, Presses Universitaires de France 2013.
[24] Robert Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Seuil et La République des Idées, Paris, 2003.
[25] Wolfgang Streeck : Entre globalisme et démocratie. L’économie politique à l’heure du néolibéralisme finissant, Gallimard 2023.
[26] J. Habermas : La constitution de l’Europe, traduction française, Gallimard 2012 ; Carlos M. Herrera : « Forme politique et espace démocratique : d’un étatisme sans Etat et de son incertain dépassement », in Une Europe politique ? Obstacles et possibles, sous la direction de Ninon Grangé et Carlos M. Herrera, Editions Kimé Paris 2021.
[27] E. Balibar : Europe, crise et fin ?, ouvr. cit. J’y discute longuement les prises de position de Habermas.
[28] Robert Schütze : « Two-and-a-half Ways of Thinking about the European Union”, in Politique européenne, n° 53/2016, cit.
[29] Catherine Colliot-Thélène : La Démocratie sans « Demos », Paris, PUF, 2011. Colliot-Thélène estime que l’inconsistance du « demos » comme fondement politique de la fédération est compensée par le rôle décisif que celle-ci a joué dans la constitutionnalisation des « droits subjectifs » de ses citoyens, ce qui constitue un point d’entrée dans la question de la garantie réciproque de « l’Etat de droit », à laquelle je n’ai pu consacrer de développement dans cet exposé dont la dimension est contrainte.
[30] « Demos et Demoï : fonder la constitution », par Kalypso Nicolaïdis et Aïcha Messina, in L’Europe en partage, Lignes 2004/1 n° 13, Éditions Léo Scheer.
[31] Oskar Negt & Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1972 (une traduction française partielle existe en français sous le seul nom d’Oskar Negt).
[32] Selon Barbara Cassin elle daterait de la conférence d’Eco lors des Assises de la traduction littéraire d’Arles (automne 1993) ou de la leçon inaugurale d’Eco au Collège de France un an plus tôt. Barbara Cassin, « La langue de l’Europe ? », Po_sie, vol. 160-161, n° 2-3, 2017, p. 154-159.
How to quote:
Cit. Etienne Balibar, « L’impossible possibilité de la fédération européenne : hier, aujourd’hui, demain » Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/limpossible-possibilite-de-la-federation-europeenne/ Published 06.07.2025
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.