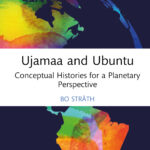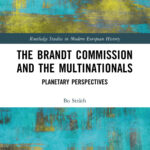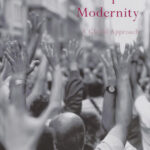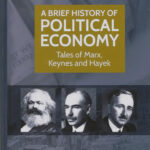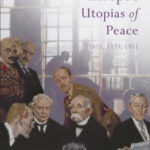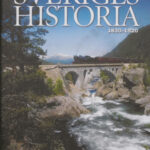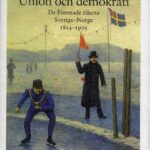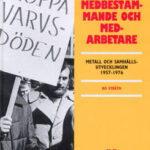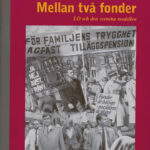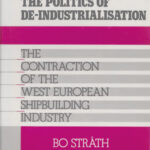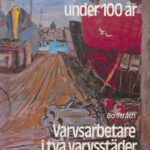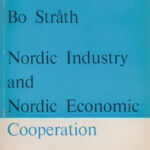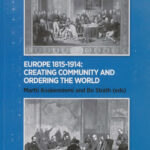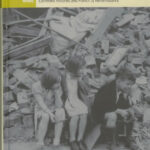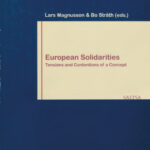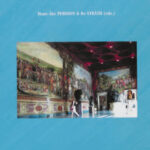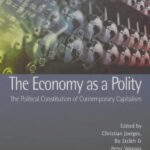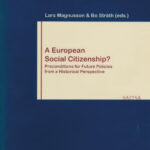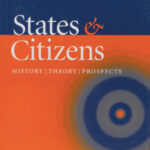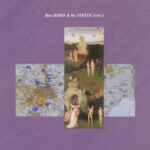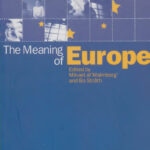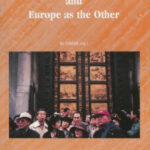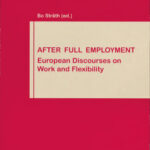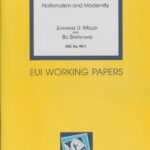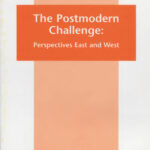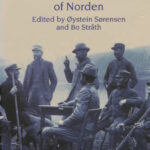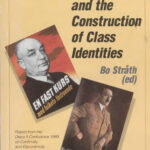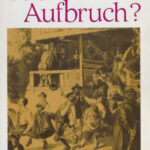Le point de départ : une brève saga occidentale qui a culminé dans les années 1960
Il serait erroné de considérer les développements aux États-Unis depuis 2016 comme un problème exclusivement américain. Les événements qui se sont produits aux États-Unis depuis 2016, et qui se sont accélérés depuis 2025, s’inscrivent dans un contexte mondial plus général marqué par l’érosion de la démocratie, un nouvel impérialisme ancien autour des idées de géopolitique et de géoéconomie, et un nihilisme des valeurs, où les convictions sur les valeurs stables sont dissoutes par les émotions fortes des réseaux sociaux numériques. Les démocraties se transforment en formes de gouvernement autoritaires et paternalistes. Le qualificatif « illibéral » remet en question les notions libérales de démocratie. Ces tendances sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. C’est cette tendance générale à la baisse, à l’origine du raz-de-marée américain de novembre 2024/janvier 2025, qui, selon Jürgen Habermas (2025 ; cf. Stråth 2025), pourrait également se produire en Europe si ses dirigeants ne prennent pas activement des contre-mesures.
La démocratie au sens moderne du terme, le suffrage universel pour les hommes et les femmes et un système parlementaire ayant une influence considérable sur le contenu de la politique ont fait leur apparition dans les années 1920, après la mobilisation massive pour la Première Guerre mondiale. La démocratie en tant qu’idéal et la lutte pour la démocratie sont plus anciennes. Cette percée ne concernait qu’une partie limitée du monde, à savoir les pays industrialisés. La mobilisation massive pour la Seconde Guerre mondiale a approfondi la substance politique du travail parlementaire avec des idées de protection sociale universelle organisée par l’État, mais dans un monde limité à ce qu’on appelait l’Occident : les États-Unis, l’Europe occidentale et le Japon (après 1945). L’expansion des États providence en Europe occidentale dans les années 1960 peut être considérée comme un âge d’or de la démocratie. Le centre de la politique était les parlements. C’est la période que le politologue irlandais Peter Mair (2013), dans un livre publié à titre posthume, considère comme l’apogée de la démocratie, lorsque le déclin a également commencé. Jusqu’alors, la politique était fondée sur des intérêts et idéologiquement motivée par les conflits d’intérêts qui se développaient dans la société industrielle. Ces intérêts et leurs idéologies ont développé des identités sociales qui s’affrontaient dans les parlements nationaux. Le travail de compromis a donné naissance à des identités nationales qui ont à la fois comblé et perpétué les conflits d’intérêts.
Si la Première Guerre mondiale a conduit à l’avènement de la démocratie, la Seconde Guerre mondiale a permis sa perfection dans une petite partie du monde, sous la forme d’États providence occidentaux à économie mixte, avec une consommation et une production de masse dans une dynamique qui se renforçait mutuellement. La théorie économique de Keynes a légitimé ce système. Cette théorie mettait l’accent sur la stimulation de la demande politique. La croissance a permis d’élargir sans cesse le gâteau, ce qui a facilité la politique de redistribution utilisant la fiscalité progressive comme instrument. Le bien-être était également un instrument idéologique de la guerre froide, une vitrine contre le socialisme d’État en Europe de l’Est. On croyait fermement que ce qui était désormais considéré comme de l’ingénierie sociale avait trouvé un ordre permanent. Mais personne ne croyait que l’histoire avait pris fin. La guerre froide menaçait de tout détruire.
La démocratie brisant les intérêts et recherchant le compromis, que Mair voyait culminer dans les années 1960, était fondée sur une discipline sociale créée sous la pression de la guerre mondiale, une discipline sociale au service de la cohésion nationale. Elle s’est poursuivie pendant la terreur nucléaire de la guerre froide. La pression s’est atténuée après les crises successives du Congo, de Berlin et de Cuba entre 1960 et 1962. Après Cuba, l’abîme ne semblait plus aussi proche. La discipline sociale s’est relâchée, avec « 1968 » comme signe visible. Les conflits liés à la distribution se sont également intensifiés (Stråth et Trüper 2025). « 1968 » a été une révolte générationnelle avec des protestations contre la consommation de masse, l’excès et la destruction de l’environnement. Les manifestants réclamaient la justice mondiale et un soutien accru aux pays en développement. La contestation s’est répandue dans tout le monde occidental avec des accents différents. En Allemagne, il s’agissait de comprendre le fait que la génération précédente avait permis et soutenu le nazisme ; en France, la cible était les mandarins des universités et le style autoritaire de De Gaulle ; aux États-Unis, c’était la guerre du Vietnam. Les manifestations occidentales ont inspiré le Printemps de Prague en Tchécoslovaquie, ce qui a conduit l’Union soviétique à intervenir militairement. Le mouvement syndical occidental a radicalisé la question de la distribution et remis en question l’esprit de consensus qui prévalait afin d’empêcher les conflits d’intérêts de dégénérer, l’esprit de négocier des solutions aux conflits. Des voix se sont élevées en faveur de la cogestion et de la démocratie d’entreprise, avec une nouvelle conception de la propriété. En résumé, la pression sur la démocratie s’est accrue de l’intérieur alors qu’elle s’est relâchée de l’extérieur pendant la guerre froide.
Quelques années avant « 1968 », la transition identifiée par Peter Mair a commencé, passant d’un compromis idéologique et fondé sur les intérêts en matière de répartition à une professionnalisation et une technocratisation de la politique, ce qui signifiait également une désidéologisation. De nouvelles théories en sciences sociales sur l’État providence et la communauté sociale ont légitimé cette évolution. Les partis politiques ont commencé à chercher à maximiser leurs votes en dehors de leurs groupes d’intérêt, affaiblissant ainsi à la fois la définition des intérêts et leur moteur idéologique. La base des compromis parlementaires est devenue plus difficile à comprendre. La politique est devenue une administration technocratique et un gouvernement par cartel, ce qui a éliminé toute opposition réelle à mesure que les différences significatives entre les partis s’estompaient. La radicalisation peut être considérée comme une protestation contre la désidéologisation et la technocratisation à une époque où les circonstances extérieures, la guerre froide, rendaient possible la lutte idéologique.
Lorsque les États-Unis ont annoncé un dimanche d’août 1971 qu’ils ne pouvaient plus respecter leur engagement de Bretton Woods de lier le dollar à un prix fixe de l’or, les conditions de la protestation ont fondamentalement changé. La chute du dollar a entraîné une inflation galopante, qui a poussé les producteurs de pétrole du monde entier, pour la plupart situés dans les pays pauvres du Sud, à augmenter considérablement leurs prix. Les livraisons de pétrole ont diminué et leur avenir est devenu incertain. La construction de superpétroliers s’est effondrée. L’industrie navale, ainsi que ses nombreux fournisseurs dans le secteur de l’acier et d’autres industries, sont entrés dans une crise structurelle accompagnée d’un chômage de masse. Il s’agissait d’une crise du régime de production fordiste, caractérisé par les chaînes de montage et le travail à la pièce. La flambée des prix du pétrole a choqué et pris de court les dirigeants politiques occidentaux, qui se sont retrouvés confrontés à une crise systémique. La vague radicale de la fin des années 1960 a pris fin.
Le tiers-monde a pris le relais là où « 1968 » et la radicalisation de la classe ouvrière s’étaient arrêtés. Ses dirigeants ont vu dans le pétrole un exemple pour d’autres matières premières. Réunis au sein du G77, ils ont exigé un nouvel ordre économique international (NOEI) avec des prix plus élevés pour les matières premières et la possibilité de nationaliser les entreprises occidentales dans les pays en développement (en échange d’une compensation). Pendant quelques années (1973-1975), ils ont fait de l’ONU le principal lieu de négociation de leurs revendications avec les pays industrialisés. Un conflit Nord-Sud s’est ajouté au conflit Ouest-Est de la guerre froide. Les dirigeants occidentaux, alarmés, ont fondé le G7 pour conjurer la menace du G77 (Stråth 2023 : 109-115).
C’est cette situation qui a conduit les employeurs et les détenteurs de capitaux à abandonner définitivement l’autodiscipline que la guerre froide leur avait imposée. À cet egard, ils ont suivi les travailleurs radicaux qui avaient exigé une plus grande influence sur les entreprises, mais bien sûr avec des objectifs différents. Le NIEO, avec ses revendications en faveur de la nationalisation des entreprises, a constitué, outre la radicalisation des travailleurs en Europe occidentale, une incitation supplémentaire à abandonner la politique de négociation tripartite (gouvernements, employeurs, syndicats) pour résoudre le conflit d’intérêts.
La crise du régime de production fordiste a donné naissance à de nouvelles façons de concevoir la productivité et le profit. L’avenir résidait dans la production de services financiers. De fortes pressions ont été exercées pour leur internationalisation, loin du contrôle des gouvernements nationaux. La rupture néolibérale a commencé. En Occident, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, soutenus par les théories économiques et politiques de Friedrich Hayek et Milton Friedman, ont mené la rupture avec l’ordre occidental d’après-guerre établi à Bretton Woods en 1944, qui avait constitué la base de plusieurs décennies de démocratie sociale fonctionnelle, qui avait si bien fonctionné que beaucoup pensaient qu’elle était garantie pour l’avenir.
Aux États-Unis, Samuel Huntington a également trouvé un tournant dans les années 1960, mais différent, lorsqu’il a réfléchi, au milieu des années 1970, à l’effondrement du dollar en 1971-1973 et à la crise mondiale qui a suivi (Crozier, Huntington et Watanuki 1975). Les masses exigeaient trop, affirmait-il. La démocratie suscitait des demandes qui dépassaient les capacités financières de l’État. Huntington proposait un équilibre entre la vitalité démocratique et la capacité du gouvernement en restreignant les possibilités démocratiques. On pourrait également dire qu’il voulait rétablir la discipline sociale. Huntington a fourni des arguments en faveur du discours néolibéral émergent, dans lequel la restriction budgétaire devenait un instrument permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire et de réduire les impôts afin de stimuler l’économie, plutôt que les dépenses publiques recommandées par le manuel keynésien. Selon Huntington, la démocratie devait être conçue de manière à se concentrer davantage sur sa forme que sur son fond. Cet argument s’accordait facilement avec l’orientation néolibérale de la politique et de l’économie dans les années 1970. Le problème, d’un point de vue démocratique, était de savoir qui devait être tenu d’exercer une autodiscipline et qui devait en être exempté. Cependant, Huntington ne l’a pas formulé ainsi.
La percée néolibérale
La percée néolibérale des années 1980, qui s’est renforcée jusqu’à atteindre une position quasi hégémonique dans les années 1990, était étroitement liée à la transition de la production de biens industriels vers les services financiers comme moteur de la croissance, notamment grâce à la déréglementation et à l’internationalisation des marchés des capitaux et du crédit, ainsi qu’au commerce des devises. Investir dans l’argent est devenu le mot d’ordre qui a conduit à un accroissement des écarts de revenus et de richesse, s’éloignant de ce qui avait caractérisé les États providence keynésiens de l’après-guerre. Le commerce spéculatif des devises a exercé une pression sur les gouvernements des États-nations qui avaient combiné leurs politiques keynésiennes de stimulation de la demande avec un contrôle strict des marchés du crédit et du commerce des devises. Cette nouvelle liberté s’est ensuite combinée à la technologie numérique pour lire les tendances et prendre des décisions spéculatives d’achat ou de vente en quelques nanosecondes, ce qui a encore accru la pression sur les gouvernements.
Le Premier ministre suédois Ingvar Carlsson et le ministre des Finances Kjell-Olof Feldt sont de bons exemples d’une situation plus générale qui a particulièrement touché les partis sociaux-démocrates européens et déclenché des tensions entre les chefs de gouvernement et les ministres des Finances, même avant l’ère numérique. Rolf Gustavsson a décrit comment, après la victoire électorale de 1988, le ton des conversations entre eux s’est durci en ce qui concerne leurs points de vue sur l’économie et les possibilités d’une politique axée sur la demande. Le Premier ministre a laissé éclater sa colère :
Que se passe-t-il dans ce pays ? Le gouvernement s’est battu pour faire adopter un budget dans lequel nous avons travaillé dur pour ramener les augmentations de dépenses à zéro afin de maintenir l’équilibre de l’économie suédoise. Dans le même temps, les banques injectent des fonds dans leurs clients pour augmenter la consommation. Il est impossible d’ouvrir un journal sans voir d’énormes publicités pour des prêts à faible taux d’intérêt. Dieu merci, que l’économie est en surchauffe (Gustavsson 2010 : 51).
Avec le recul, Carlsson a décrit la déréglementation du marché du crédit comme sa plus grande erreur au cours de ses sept années en tant que Premier ministre. Avec le recul, Feldt a admis avoir sous-estimé les conséquences de la déréglementation, mais a également affirmé qu’il n’y avait pas d’autre choix (Gustavsson 2010 : 50-55).
La libération des détenteurs de capitaux des barrières nationales a contraint les gouvernements à faire preuve de retenue dans les dépenses publiques. Les déficits importants ont entraîné une hausse des taux d’intérêt sur les prêts qui les finançaient, ce qui a réduit la marge de manœuvre pour de nouvelles visions d’avenir et des politiques créatives. La politique s’est de plus en plus concentrée sur la gestion administrative des ressources dans des cadres donnés.
Ce qui est intéressant dans les points de vue des deux sociaux-démocrates, c’est la position du ministre des Finances, qui estime qu’il n’avait pas le choix, et l’opinion du Premier ministre, qui regrette sa décision, ce qui signifie qu’il considère qu’il avait le choix. Il faut donner raison à Carlsson : il y avait bien sûr un choix. Mais la question est de savoir à quel prix un petit pays pouvait se permettre de rester en dehors d’une tendance internationale présentée comme la seule voie possible. Mener une politique budgétaire à contre-courant des marchés financiers internationaux n’était pas une tâche facile. L’émergence de l’hégémonie du cadre interprétatif néolibéral rendait difficile de résister à la pression en faveur de la déréglementation et de l’internationalisation. En France, François Mitterrand a tenté de poursuivre les politiques keynésiennes en 1981-1983, mais la réaction des marchés financiers l’a contraint à abandonner cette tentative. Une fois la déréglementation mise en place, les gouvernements sont restés vulnérables aux opinions des opérateurs de marché, ce qui a limité leur marge de manœuvre. Quoi qu’ils fassent, les opérateurs financiers (« le marché ») les ont mis dans un carcan.
Plus que quiconque, Margaret Thatcher est associée à TINA, There Is No Alternative, il n’y a pas d’alternative (au marché). Après 1990, cette phrase est devenue de plus en plus un slogan directeur. Son utilisation n’impliquait aucune réflexion approfondie sur ce qu’était le marché. Le marché est devenu un fétiche, une abstraction qui s’est concrétisée dans l’incapacité politique d’agir. Les forces à l’origine de la mystification du marché n’hésitaient pas à frapper si elles estimaient que les gouvernements agissaient de manière erronée. Ce faisant, elles agissaient comme un banc de poissons. Le changement dans le contrôle des taux de change et des taux d’intérêt a eu des répercussions politiques importantes. Margaret Thatcher a renforcé l’impression d’une démocratie de plus en plus impuissante en arguant qu’elle n’avait pas d’autre choix que de se plier aux exigences du marché. La tendance à la professionnalisation et à la technocratisation de la politique dans les démocraties occidentales observée par Peter Mair dans les années 1960 s’est accélérée, non pas parce que la politique consistait à gérer les affaires publiques de manière à maximiser les votes, mais parce qu’il n’y avait pas d’alternative aux diktats du « marché ». Les conflits politiques et la concurrence entre des alternatives offrant des visions différentes de l’avenir ont disparu lorsque tout le monde s’est rassemblé dans un terrain d’entente politique, dans une sorte de cartel des partis. Au départ, ce rassemblement visait à maximiser les votes, ce qui, après 1990, dans le cadre du néolibéralisme, s’est combiné à une adaptation au marché. Le terme « post-politique » a été inventé pour décrire cette évolution. Lorsque les protestations contre cet arrangement se sont intensifiées et que les partis établis se sont révélés incapables de répondre au mécontentement, faute d’alternatives à la « gestion au jour le jour » technocratique établie, des entrepreneurs politiques ont émergé, capables de répondre à la frustration (Pepijn 2019). Il s’agissait des paternalistes autocratiques décrits par Stephen Hanson et Jeffrey Kopstein (2024) dans le premier article d’Un ordre mondiale en plein dissolution (Stråth 2025), avec Donald Trump comme figure de proue.
Colin Crouch (2009) a décrit comment les politiques budgétaires keynésiennes des gouvernements, axées sur la demande, ont progressivement cédé la place à des banques privées stimulant la demande par le crédit, ce qui est allé de pair avec la privatisation d’une série de services publics et municipaux dans des domaines tels que l’éducation et la santé. Crouch a théorisé les expériences d’Ingvar Carlsson et de nombreux autres dirigeants politiques. Crouch parle de keynésianisme privatisé. La passivité croissante des États a conduit à une privatisation de la stimulation de la demande, qui est passée des budgets publics à de nouvelles formes de crédit, en particulier les cartes de crédit.
Dans un centre politique édulcoré et déidéologisé, ou hégémonique et hautement idéologisé, si vous préférez, il existait un consensus général selon lequel les parlements étaient soumis aux exigences du marché. Le discours néolibéral sur la mondialisation, qui a été hégémonique après 1990 jusqu’à l’effondrement de 2008, a légitimé cet ordre sans grand débat. Comme mentionné, il n’y avait pas d’alternative. Sous la surface discursive, les marchés du travail ont subi des changements fondamentaux, notamment en termes de représentation des intérêts, en particulier la représentation syndicale, avec de grands groupes de travailleurs précaires à bas salaire échappant au système de protection sociale. Les marchés financiers ont également subi des changements fondamentaux en raison de leur internationalisation presque complète, qui a eu un effet d’entraînement sur les restrictions budgétaires des gouvernements nationaux. Le revers du discours sur la mondialisation, à savoir la réduction de la liberté d’action des gouvernements nationaux et l’émergence d’un précariat transnational, a disparu sous l’hégémonie de ce discours.
Démocratie de faible intensité
Susan Marks (2000) a été l’une des premières à contribuer à un corpus plus large de littérature montrant comment la démocratie néolibérale est devenue une démocratie de faible intensité : formelle, avec le suffrage universel, mais sans grande influence sur le fond de la politique. C’est cette forme qui s’est répandue à travers le monde avec le discours sur la mondialisation, où la démocratie sous le marché était la forme de gouvernement qui devenait de plus en plus courante. L’économie néolibérale allait de pair avec la démocratie néolibérale, une nouvelle forme de démocratie par rapport à celle qui avait construit les États providence. La critique sociale animée des années 1960 a disparu et la nature du débat public a changé. La norme et la nomenclature permettant de définir la démocratie se sont appuyées sur des critères formels tels que le suffrage, des élections générales libres et secrètes, la liberté d’expression, etc., mais rien n’a été dit sur la manière dont les électeurs pouvaient influencer le fond politique de questions telles que la justice sociale et le bien-être. Les divisions sociales croissantes à la suite de la mondialisation ont été laissées de côté. Marks montre comment des élections libres et équitables n’ont pas remis en cause les concentrations de pouvoir et les injustices sociales profondes. Elle soutient en outre que l’idéologie entourant la démocratie de faible intensité essentialise le concept de démocratie de faible intensité en le polarisant contre la non-démocratie plutôt que contre la forme précédente, plus axée sur le fond. Elle parle d’évasion téléologique lorsqu’elle affirme que les droits politiques dignes de ce nom, et pas seulement la forme, doivent passer avant les droits économiques et sociaux, et que les droits politiques consistent à pouvoir façonner l’avenir et changer ce qui est perçu comme mauvais. Par droits politiques, elle entend la capacité d’influencer le contenu de la politique, et pas seulement d’applaudir en acclamant.
Andrew Lang (2011), qui, comme Marks, écrit dans une perspective de droit international, soutient l’argument selon lequel le développement d’une démocratie formelle de faible intensité est au cœur de la percée néolibérale, à savoir la dépolitisation de la politique. Les années 1990 ont vu une forte expansion de la démocratie dans le monde à la suite de l’effondrement de l’empire soviétique. Cette expansion ne s’est pas limitée à l’Europe de l’Est. Des sociétés civiles avec des mouvements démocratiques et le renversement de dirigeants autocratiques ont émergé presque partout en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Les médias se sont réjouis de la chute des régimes autoritaires et de la percée de la démocratie, qui allait de pair avec le triomphe du discours néolibéral sur la mondialisation.
Dans les commentaires académiques critiques qui ont émergé après 2000, le terme « faible intensité » exprimait la même chose que le terme « sans alternative ». La faible intensité était le concept critique issu de l’analyse académique extérieure au processus politique, tandis que « sans alternative » était le concept disciplinaire issu de l’intérieur, utilisé par les dirigeants politiques. Les deux termes signifiaient que la démocratie sous sa forme néolibérale était davantage une question de forme que de fond et qu’elle était fondamentalement l’expression d’une dépolitisation. La démocratie édulcorée en Occident sous le concept d’« alternativlos » (Merkel) n’avait existé que pendant quelques décennies après la Seconde Guerre mondiale, mais elle reposait sur un siècle et demi de lutte depuis les années 1830, en tant que contre-mouvement aux inconvénients de l’industrialisation et à la mobilisation des populations pour deux guerres mondiales. L’idée que la démocratie, telle qu’elle s’était établie en Occident après 1945, se répandrait dans le monde entier tout en étant vidée de son sens en Occident était, bien sûr, une illusion qui a été habilement dissimulée sous le puissant discours de la mondialisation. Personne ne voulait voir qu’il existait une différence entre la démocratie et la démocratie.
Samuel Moyn (2010, 2018) a montré comment les droits de l’homme ont suivi la démocratie dans l’érosion de la substance et la concentration sur la forme. Un droit humain important est devenu la protection de la propriété, tandis que les droits sociaux étaient insignifiants. Les multinationales sont devenues des sujets couverts par les droits de l’homme. On devine derrière cette position les revendications des pays en développement qui souhaitent nationaliser les entreprises. Moyn parle des droits de l’homme dans le tourbillon néolibéral (Moyn 2018 : 173 ; cf. Stråth 2023 : 161). En droit international, on est passé des États aux individus en tant que sujets de droit, les entreprises en tant que personnes morales étant également assimilées à des individus en tant que personnes physiques.
La démocratie à faible intensité a évité d’aborder le conflit d’intérêts sur le marché du travail, et les questions de démocratie d’entreprise et de redistribution ont disparu du débat. Une grande partie des marchés du travail de plus en plus segmentés ont été exclus de la représentation des intérêts. Le conflit de classes a disparu de la théorie démocratique. Les idées d’une société consensuelle sans classes ont accompagné les signes croissants de marginalisation sociale et de désintégration sociétale. Dani Rodrik (2000) évoque le trilemme de la mondialisation, dans lequel l’État-nation, la démocratie et le marché sans frontières forment un triangle, mais seuls deux d’entre eux peuvent coexister. Rodrik décrit des contextes théoriques plutôt qu’empiriques : la démocratie et l’État-nation ne peuvent fonctionner avec un marché sans frontières. La démocratie et un marché sans frontières ne peuvent fonctionner avec des États-nations comme lieu de la démocratie. Les États-nations ne peuvent être démocratiques si le marché est sans frontières.
Paternalisme autocratique
L’effondrement néolibéral dans une bulle spéculative américaine en 2008, gonflée par la croyance naïve et sans frontières du monde dans le dollar, a provoqué un choc après les plans de sauvetage financiers massifs mis en place par les gouvernements pour sauver les banques spéculatives, trop grandes pour faire faillite. La politique est restée sans alternative au sens thatchérien du terme, c’est-à-dire dictée par le marché. Les opinions se sont formées en se concentrant sur les perdants de la mondialisation. L’hégémonie concernait les gagnants comme voie vers le succès pour tous. L’économiste grec Yanis Varoufakis (2011 : 135), qui a également été ministre des Finances pendant un certain temps, a formulé la différence entre les gagnants et les perdants : « Les riches… avaient découvert un moyen ingénieux de s’enrichir davantage : en négociant des actifs papier qui recelaient les rêves, les aspirations et, finalement, le désespoir des plus pauvres de la société. » Les perdants ont exprimé la colère populaire et le mépris des politiciens envers les partis établis et leurs représentants. Lorsque les entrepreneurs politiques ont commencé à canaliser avec succès ce mécontentement, ils se sont concentrés sur la nation en tant que perdante de la mondialisation qui devait être recréée. Une protestation nationaliste populiste s’est élevée, dirigée contre l’establishment politique qui avait géré la mondialisation, les « cosmopolites » et les « mondialistes ». Utilisant des concepts tels que la démocratie illibérale, des dirigeants aux idéaux autoritaires se sont lancés dans la lutte contre la démocratie néolibérale. Le paternalisme s’est répandu comme style de gouvernement, comme l’ont noté Hanson & Kopstein (2024) et d’autres dans une riche littérature de recherche (voir, par exemple, Levitsky & Ziblatt 2018 et Lewis 2018). Cette évolution a été suivie par des arguments plus radicaux sur un « État profond » où les experts étouffaient toute initiative, ainsi que par d’autres théories du complot, comme le documentent Hansson & Kopstein (2024) dans un chapitre intitulé « The Deep State Bogeyman » (Le spectre de l’État profond). C’est cette évolution qui constitue la toile de fond des États-Unis de Trump, tels que décrits dans la première partie d’Un ordre mondiale en plein dissolution (Stråth 2025).
Les réactions à l’effondrement financier et au sauvetage massif financé par l’argent des contribuables ont entraîné un glissement de la politique vers la droite, sous la forme d’un populisme et d’un paternalisme autoritaire qui remettaient en cause l’administration parlementaire d’une politique dont on disait qu’elle n’avait pas d’alternative. Depuis 1990, tout le monde s’était rallié au principe d’un juste milieu imaginaire défini par le marché et ce que l’on disait être ses exigences. Jusqu’au triomphe d’une politique sans alternative, la ligne de conflit parlementaire séparait la droite et la gauche, toutes deux définies par leur idéologie et leurs intérêts. Le conflit et le compromis entre elles maintenaient le juste milieu. Le fait est que les compromis étaient basés sur des divisions idéologiques et définies par des intérêts, qui renforçaient le juste milieu, mais qui étaient désormais étouffés par ce qui était présenté comme un marché sans alternative. L’espace de négociation qui renforçait la démocratie a disparu. Après 2008, la ligne de conflit est réapparue, mais désormais non plus au centre, mais à droite du centre, une ligne qui, pendant longtemps, a fait l’objet d’un débat pour savoir s’il s’agissait d’une frontière, d’un pare-feu ou d’une ligne de négociation. Le changement s’oriente vers la ligne de négociation entre la droite modérée et la droite populiste. C’est autour de cette ligne que Marie Le Pen et Emmanuel Macron jouent au chat et à la souris pour savoir qui est le centre représentant la nation et qui est la droite, divisant ainsi la nation. Leurs deux tentatives pour l’unir la rendent très polarisée. Dans le principe de maximisation des votes qui s’applique, le centre autoproclamé adopte verbalement la rhétorique populiste de droite et déplace le contenu politique vers la droite, mais prétend qu’il est meilleur parce qu’il vient du centre ou de la gauche. Dans l’ensemble, on observe un glissement vers la droite des normes, du langage et du contenu politique. La question de l’immigration en est le catalyseur.
La France n’est qu’un exemple parmi d’autres. Ce schéma s’observe dans l’Union européenne, où le chef des partis conservateurs au Parlement européen, le PPE, Manfred Weber, cherche un terrain d’entente entre les populistes de droite et la gauche, tandis que les anciens partis centristes sont également écartés par l’aile droite de Weber, qui prétend être le centre. Lorsque la droite modérée, libérale-conservatrice, tente de se définir comme le centre, elle suit automatiquement une ligne de négociation vers la droite, vers l’extrême droite. Dans cette perspective, la chef du gouvernement populiste de droite italien, Georgia Meloni, joue un rôle clé non seulement en Italie, mais aussi dans l’UE. Elle est également chérie par l’administration Trump, qui ne souhaite rien de plus que de faire du populisme de droite conflictuel en Europe une tendance dominante. [1]
L’érosion de la démocratie après 2008, qui est passée d’un statut de faible intensité à des régimes illibéraux, autoritaires et paternalistes, a longtemps été décrite comme une mort lente, même pendant le premier mandat de Trump (Levitsky & Ziblatt 2018). Après six mois du deuxième mandat de Trump, il faut parler d’un déclin aux États-Unis qui s’apparente à un glissement de terrain. Personne ne parle plus de mort lente. C’est cette situation que l’Europe doit enfin aborder, de manière autocritique mais avec confiance, sans marmonner entre ses dents. Et se demander à quel point elle est proche d’une évolution à l’américaine.
Le problème nihiliste : l’illimité, l’immodéré, l’insensé, la sans-valeur
Après l’abandon du régime de production fordiste, qui reposait sur la fabrication industrielle avec des études de temps, le travail à la pièce et les chaînes de montage comme méthodes, et des investissements dans des installations fixes (briques et mortier) qui duraient des décennies et utilisaient le pétrole comme combustible, un état d’esprit monétaire a émergé. La création de valeur lucrative de l’avenir ne résidait pas dans la production de biens industriels, mais dans le commerce des services financiers. La valeur ajoutée résidait dans l’argent lui-même, qui était à la fois le nouvel intrant et le produit fini. Dans cette optique, la résistance s’est accrue face au contrôle exercé par les gouvernements nationaux sur le commerce des devises et autres services financiers. Les demandes en faveur du libre-échange transfrontalier des services financiers se sont multipliées. Au cours des années 1990, les marchés financiers ont été libérés de leurs liens nationaux, mais cette libéralisation avait déjà commencé dans les années 1980.
La monétisation de l’économie a connu une croissance exponentielle, le moteur de la croissance économique passant des actifs fixes aux portefeuilles monétaires. Le profit résidait dans l’investissement dans l’argent et le commerce de l’argent. La monnaie, qui servait de référence pour déterminer les prix dans le commerce des matières premières, est elle-même devenue l’objet de la fixation des prix et a ainsi acquis une valeur volatile. La monétisation de l’ère néolibérale a progressivement transformé les valeurs en prix, les rendant relatives, négociables et sujettes à la spéculation. La pierre angulaire de l’ancien ordre, le prix de l’or, a disparu dans un océan de valeurs flottantes. Sur le marché sans frontières, même les valeurs qui sous-tendaient la démocratie sont devenues négociables. Non seulement les valeurs matérielles, mais aussi les valeurs immatérielles et les principes éthiques sont entraînés dans la tendance nihiliste où tout a un prix négociable. Les valeurs absolues et inestimables deviennent précieuses et négociables. Les droits de l’homme n’étaient pas aussi absolus qu’on le disait. Cela n’était pas seulement vrai aux États-Unis. Les gouvernements européens et l’UE versent des pots-de-vin à des dirigeants autoritaires sans scrupules au sud de la Méditerranée afin que leurs représentants défendent la nihilisation du canon des valeurs européennes. Le droit d’asile a un prix et n’est plus absolu. Les valeurs deviennent illimitées, excessives, insensées et sans valeur (Stråth et Trüper 2025).
Donald Trump est l’illustration parfaite de cette évolution, l’homme des techno-oligarques pour créer de nouvelles valeurs. Rien ne représente mieux cette création de valeurs autour de l’illimité, de l’immodéré et de l’absurde, qui aboutit à l’insignifiance, que l’image que Trump se fait de lui-même en tant que pape grâce à l’IA. Dans son narcissisme sans pareil, il croit peut-être en cette image comme une réalité possible, tout comme il croit en lui-même en tant que lauréat du prix Nobel de la paix, ce qui est en soi une forme de nihilisme où l’on croit que tout peut s’acheter. La numérisation du commerce des valeurs a accéléré cette évolution. Les réseaux sociaux développent une dynamique qui se renforce mutuellement entre la création constante de nouvelles valeurs et la consommation de valeurs (Stråth et Trüper 2025).
Un aspect important du nihilisme est que les règles et les codes culturels de la sphère publique et de la représentation du pouvoir politique sont en train de disparaître. Le public devient privé et le privé devient public. Dans un article, l’historien Christopher Clark raconte une conférence de presse télévisée à la Maison Blanche en février 2025, au cours de laquelle le premier copain Elon Musk devait rendre compte du nouveau DOGE, le département de l’efficacité gouvernementale. Clark a été horrifié lorsqu’il a vu et entendu Musk parler de manière incohérente et sans preuve de la façon dont lui et son équipe avaient découvert une fraude à grande échelle et une corruption sans fond. Le président Trump était assis à son bureau dans le Bureau ovale, vêtu d’un costume sombre. Musk était debout, vêtu d’un jean et d’un manteau, avec une casquette MAGA sur la tête, qu’il n’a retirée que pour essuyer la sueur de son front. Ses mouvements étaient maladroits et il parlait sans établir de contact visuel avec les journalistes accroupis devant lui. Il était peut-être sous l’influence de la kétamine. Il avait amené avec lui son fils de quatre ans, prénommé X Æ A ‒Xii. Pendant que son père parlait, le fils se curait le nez et, au grand désarroi apparent du président, en étalait le contenu sur le coin du vénérable bureau Resolute (Clark 2025). Aucun des acteurs ne semblait capable de comprendre le caractère public de la conférence de presse. Elle était aussi publique qu’un tel événement peut l’être dans une salle qui, pour la plupart des Américains, représente plus que tout autre chose l’autorité de la présidence. L’informalité radicale dont faisaient preuve les deux hommes et l’enfant, comme s’ils se réunissaient en privé chez eux, était obscène, écrit Clark.
L’exemple est peut-être extrême, mais il représente une tendance : l’effondrement de l’ordre public. Un autre exemple est la réunion de l’OTAN à La Haye en juin 2025, où les courbettes et les flatteries devant Daddy Donald, comme l’appelait le secrétaire général, étaient l’expression de ce qu’il faut qualifier de crise historique de sens. En temps de guerre, alors qu’il y avait des questions existentielles à discuter, 32 chefs d’État et de gouvernement se sont réunis dans le but principal de maintenir Trump de bonne humeur. Dans cette optique, la réunion devait être brève, ne durer que quelques heures, afin que l’attention de Trump ne se relâche pas. Tout le monde s’est félicité lorsque l’objectif a été atteint grâce à l’absence de sujets de fond à discuter. Tout cela n’était qu’une cérémonie de cour où l’on s’aplatissait devant le leader numéro 1, tel un veau d’or. Le secrétaire général était visiblement ravi de son rôle de bouffon en chef. La seule question à l’ordre du jour était celle des 5 % du PNB consacrés à la défense, mais il ne s’agissait pas d’un sujet de discussion, mais d’un diktat, un chiffre mystique bizarre sorti de nulle part par Trump, qui a été accepté avant la réunion sans aucune discussion de fond. Est-ce ainsi que les dirigeants européens veulent garantir la sécurité de l’Europe ? Si ce n’est pas le cas, pourquoi agissent-ils ainsi ? Une réunion où Trump, pourtant imprévisible, est resté calme est présentée comme une confirmation du sérieux de l’engagement des États-Unis envers l’OTAN. Vraiment ? Pourquoi n’y avait-il aucun adulte dans la salle ? Aucune colonne vertébrale ? Aucune confiance en soi ni aucun respect de soi ? Aucune qualité de leadership ? Cet événement était un feuilleton télévisé, où le public ne s’intéressait pas à la discussion de questions sérieuses, mais aux codes cérémoniels de la cour et à l’interprétation des signes, et où les réseaux sociaux ont ensuite passionnément débattu de questions telles que la question de savoir si un sourire était en réalité un rictus.
La croyance dans les possibilités illimitées du marché, renforcée pendant les années fastes des années 1990, était liée à une croyance tout aussi forte dans les possibilités du présent lorsque, dans le cadre de la libéralisation des marchés financiers, le contrôle des prêts a été privatisé au profit des émetteurs de cartes de crédit et d’autres sources financières qui accordaient des crédits pour la consommation immédiate. Les horizons lointains de l’avenir de l’ère de la planification, lorsque la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale a pris son essor et que les États providence se sont développés, ont disparu dans une brume lointaine, et l’attention s’est portée sur un présent trépidant où il était important de consommer tant que la fête durait. Elle était censée durer longtemps, mais le présent était toujours trépidant en raison de la frénésie. Le régime temporel moderne qui entourait la distinction entre le passé, le présent et l’avenir, et qui maintenait la cohésion du système de valeurs, s’est dissous et a laissé place à un présentisme sans limites (Hartog 2003 ; Stråth 2023).
Le pouvoir d’interprétation néolibéral et la monétisation, la libéralisation des marchés financiers, combinés au pouvoir numérique des médias sociaux, ont conduit le développement vers l’illimité, l’excessif, l’insensé, et ont abouti à la sans-valeur dans un présent devenu permanent. Une expression typique de l’immodéré et de l’insensé a été l’affirmation du banquier allemand Josef Ackermann selon laquelle un rendement annuel de 25 % était la norme future pour les investissements en capital et les transactions monétaires. Il portait son objectif comme un ostensoir devant lui, proclamant inlassablement qu’il était réaliste. L’objectif était un dogme. Les connaissances sur Internet étaient illimitées. Les algorithmes entre les mains des opérateurs financiers ont créé des valeurs d’une ampleur jusqu’alors inimaginable et ont conduit le jeu vers l’abîme, où tout a été détruit lors de l’effondrement de 2008. La démocratie et le nihilisme ne font pas bon ménage. La démocratie est fondée sur des valeurs.
Le pouvoir des algorithmes
Les réseaux sociaux sont devenus un excellent amplificateur de ce présentisme de l’excès, où les communications sont devenues plus courtes, plus rapides et plus univoques. Avec l’aide des algorithmes, il en a résulté un langage corrompu, où l’hostilité et les émotions ont changé le débat public et le discours politique de manière dévastatrice, avec des simplifications et des abréviations de questions complexes. La dureté et les émotions n’étaient certes pas nouvelles dans le débat public, mais leur rythme et leur propagation étaient nouveaux et rendaient tout plus compressé. Les réseaux sociaux sont à l’origine de l’infantilisation et de la banalisation de la politique, chaque politicien et autre personnalité publique qui se respecte se sentant obligé d’exprimer son opinion sur tout, du plus grand au plus petit, afin de montrer qu’il est présent. Le langage s’appauvrit lorsque les émotions et les pensées intellectuelles sont exprimées à l’aide d’émojis.
Giuliano da Empoli a expliqué dans un court essai, à l’aide d’une analogie historique, non seulement ce qui est en jeu, mais aussi le manque de conscience de l’offensive des oligarques technologiques. Au cours des trois dernières décennies, les dirigeants politiques des démocraties occidentales se sont comportés comme les Aztèques face aux inventions technologiques des conquistadors, écrit da Empoli. Confrontés à la foudre et au tonnerre de l’internet, des réseaux sociaux et de l’IA, ils se sont soumis dans l’espoir qu’un peu de poussière de fée tombe sur eux. Leur docilité n’est pas une solution pour assurer la survie de la démocratie. Après avoir prétendu respecter les règles de la démocratie tant qu’ils étaient en position d’infériorité, les conquistadors oligarchiques technologiques ont progressivement imposé leur empire aux Aztèques sans méfiance sous une forme moderne (da Empoli 2025 : 12-13). En Europe, les gouvernements existent toujours en tant que contrepoids supposé au pouvoir des plateformes technologiques, mais avec de vagues ambitions de le réglementer. Aux États-Unis, la situation semble être celle d’une fusion avec le pouvoir gouvernemental. La démocratie européenne est leur prochaine cible.
Dans son style aphoristique, da Empoli raconte ses impressions lors de réunions à travers le monde en tant que conseiller de personnalités politiques italiennes de premier plan et décrit à quel point il était difficile pour les politiciens de comprendre et d’accepter les implications de la révolution numérique.
Mais il y avait des exceptions. Da Empoli raconte, entre autres, qu’Henry Kissinger, lors d’une conférence en 2015, avait l’intention de ne pas assister à la session sur l’intelligence artificielle, dont il ne savait rien. Mais, avec une précision toute allemande, il s’y est rendu quand même. Et là, il a été frappé par la foudre : le fondateur de DeepMind présentait un logiciel capable de battre le champion du monde de Go. Kissinger a immédiatement compris qu’il y avait beaucoup plus en jeu que la numérisation d’un jeu de société. Et contrairement à ce qu’il avait pensé, cela le concernait directement, en sa qualité d’« historien et homme d’État à temps partiel ». Pour la première fois, a noté Kissinger, la connaissance humaine perd son caractère personnel, les individus sont transformés en données, et les données deviennent dominantes. L’IA n’est pas seulement un simple accélérateur de pouvoir comme la politique, mais une nouvelle forme de pouvoir qui diffère de toutes les machines que les humains ont inventées jusqu’à présent. Si l’automatisation concernait les moyens, l’IA concerne les fins. Elle fixe ses propres objectifs et développe des capacités que l’on pensait réservées aux humains. Elle prend des décisions stratégiques pour l’avenir.
Alors que ses jeunes collègues et défenseurs de la démocratie ou les optimistes du monde des affaires de Davos, les bienveillants Davos men, ne voyaient encore qu’un défi technique, Kissinger a compris que l’IA était un défi politique. Parmi les hommes d’État de la génération de Kissinger qui avaient connu la guerre dans leur jeunesse, aucun n’est tombé dans le piège de considérer le pouvoir comme une compétition entre technocrates armés de présentations PowerPoint, résume da Empoli à partir de ses impressions lors des réunions (2025 : 126-127).
Le dilemme qui a caractérisé la politique au XXe siècle était la relation entre l’État et le marché : dans quelle mesure nos vies et les fonctions de la société devaient-elles être contrôlées par l’État, et dans quelle mesure devaient-elles être laissées au marché et à la société civile ? Partant de ce constat, da Empoli soutient que la ligne de démarcation décisive au XXIe siècle sera celle entre les humains et les machines. Dans quelle mesure nos vies doivent-elles être soumises à de puissants systèmes numériques, et à quelles conditions ? En fin de compte, les individus et les sociétés doivent décider quels aspects de la vie doivent être réservés à l’intelligence humaine et quels aspects doivent être confiés à l’IA ou à la collaboration entre les humains et l’IA. Et chaque fois qu’ils choisissent de donner la priorité aux humains, alors que l’IA aurait pu garantir des résultats plus efficaces, il y aura un prix à payer (da Empoli 2025 : 131). Et vice versa, pourrait-on ajouter.
Alors, qui devrait déterminer la relation entre l’IA et l’intelligence humaine ? À l’heure actuelle, il ne fait aucun doute que ce sont les oligarques de la technologie qui considèrent ce choix comme leur tâche. Si l’on considère le vice-président Vance comme un représentant de la politique et que l’on examine sa déclaration à la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2025 (Stråth 2025), il ne fait aucun doute que, dans tous les cas, les principaux représentants de la politique américaine sont d’accord. Da Empoli oppose la vision de Kissinger sur l’IA, fondée sur une solide culture historique, à l’ignorance de Mark Zuckerberg. « C’est formidable d’être de retour à Pékin », écrit le PDG de Facebook sur une photo de lui en short de jogging sur la place Tiananmen, où des milliers d’étudiants ont été massacrés par l’armée en juin 1989 (da Empoli 2025 : 126).
La conclusion est évidente. Il est fondamental que les parlements et les gouvernements prennent le contrôle et réglementent l’IA, et qu’ils le fassent de manière décisive et avec une grande clarté. Les dirigeants européens doivent donc prendre position contre les politiques représentées par le vice-président américain. Il ne s’agit pas seulement de règles concernant l’IA, mais aussi de l’interaction sur Internet et de la création de plateformes européennes, de clouds de stockage de données, de systèmes de navigation (dont la base existe avec Galileo), etc. Il s’agit également de prendre conscience que le temps presse. Enfin, il s’agit de la détermination à ne pas acheter la liberté des droits de douane américains sur les marchandises en renonçant à la réglementation des algorithmes dans le commerce des services.
Et maintenant, Europe ?
Dans la situation décrite ici, il est temps de se rallier à l’argument d’Étienne Balibar en faveur d’une Europe sociale comme réponse à la situation (Balibar 2025). La tâche consiste à rechercher les conditions historiques de la proposition de Balibar.
Au cours des années 1970, le projet d’intégration européenne était difficile à mettre en œuvre. La politique agricole était mal orientée et l’union douanière était insuffisante pour permettre à l’Europe de trouver sa place dans l’ordre mondial. La crise qui a suivi l’effondrement du dollar a jeté une ombre sur le projet. Le président français Valéry Giscard d’Estaing et le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt ont travaillé à la création d’une monnaie européenne pour remplacer le dollar. Auparavant, Edward Heath, Premier ministre du Royaume-Uni, membre de la CEE depuis 1973, et le chancelier ouest-allemand Willy Brandt avaient esquissé une union monétaire entre une monnaie de la CEE et la livre sterling, un projet plus avancé que celui de Giscard d’Estaing et Schmidt. En 1974, Heath a été contraint de quitter ses fonctions par Margaret Thatcher, qui avait des idées complètement différentes, et Willy Brandt a démissionné après la découverte d’un espion est-allemand dans sa chancellerie (Stråth 2023 : 179-180). Le moment kairos européen en réponse à la chute du dollar est passé, mais leurs successeurs, d’Estaing et Schmidt, ont continué à travailler dans une direction plus technocratique. Ils convoquèrent les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Italie à une réunion à Rambouillet, près de Paris, en novembre 1975. Ce fut le point de départ de ce qui devint le G7 l’année suivante, lorsque le Canada rejoignit le groupe. Giscard d’Estaing et Schmidt souhaitaient avant tout obtenir l’accord des États-Unis pour une coopération monétaire européenne plus indépendante afin de remplacer le dollar en déclin. Kissinger s’opposait fermement à ces projets, mais la réunion a permis de trouver une solution à l’effondrement imminent. La question monétaire a été mise de côté et un accord a été conclu sur un front uni des pays industrialisés contre les revendications du NOEI du tiers monde, le G7 contre le G77 (Stråth 2023 : 109-115).
La coopération monétaire européenne s’est articulée autour de l’écu et du serpent monétaire, dans l’ombre d’un dollar qui se redressait sans étalon-or. Mais pendant la morosité des années 1970 en Europe, les demandes en faveur d’une Europe plus unie se sont multipliées. Ce mouvement est passé des devises à la représentation. En 1979, les citoyens des neuf États membres ont élu pour la première fois leurs représentants au Parlement européen, qui était auparavant une assemblée de délégués nommés par les gouvernements.
« Le dollar est notre monnaie, mais c’est désormais votre problème », avait déclaré le secrétaire américain au Trésor aux Européens lorsque les États-Unis ont abandonné l’étalon-or. Le dollar flottait librement par rapport aux autres monnaies, mais, faute d’autre chose, il restait la mesure de la valeur, même sans être adossé à l’or. Toutes les autres monnaies ont dû s’adapter. Le problème était que plus le dollar s’affaiblissait, plus l’inflation augmentait. En 1979, la Réserve fédérale a tiré le frein d’urgence avec une politique de resserrement inhabituelle qui a fait monter en flèche les taux d’intérêt, baisser les salaires réels et augmenter le chômage. C’était l’abandon des idées keynésiennes par l’administration Carter. Pour éviter la fuite des capitaux vers l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe occidentale s’est lancée dans une guerre des taux d’intérêt avec les États-Unis, qu’elle a finalement dû abandonner. Le président Reagan a poursuivi dans la même voie avec un dollar plus fort, libéré de toute contrainte, et un démantèlement rapide du système de Bretton Woods, qui avait constitué en Europe le cadre des économies mixtes keynésiennes. Dans le nouvel ordre, le dollar a continué à régner en maître, sans autre garantie que la confiance qu’on lui accordait faute de mieux, et les Européens se sont adaptés. Le démantèlement de Bretton Woods s’accompagna d’une célébration apologétique de la théorie du libre-échange économique en matière de biens, de capitaux et de services. La déréglementation, la libre circulation des capitaux, la privatisation, les réductions d’impôts sur les sociétés, la réduction de l’appareil étatique (« big government ») et de l’État providence (qui, aux États-Unis, n’a jamais eu la même dimension qu’en Europe, malgré le programme Great Society de Lyndon Johnson) devinrent les instruments économiques de l’ère Reagan (Wilenz 2008 ; Arrighi 2010). L’Europe a emboîté le pas. Le président français François Mitterrand et le ministre des Finances Jacques Delors ont fait une dernière tentative keynésienne pour stimuler la demande en 1981, comme nous l’avons vu, mais les attaques contre le franc et la fuite des capitaux qui s’ensuivit les ont contraints à jeter l’éponge deux ans plus tard.
En tant que ministre des Finances, Delors a été contraint de mettre en œuvre une politique d’austérité budgétaire, qu’il a appliquée avec une telle rigueur que la Première ministre britannique Margaret Thatcher et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, tous deux fidèles disciples de Reagan, l’ont considéré comme un nouveau converti à la théorie néolibérale. Lorsque Mitterrand, pour des raisons plus personnelles, a refusé de nommer Delors à la présidence de la Commission en 1985, ils sont intervenus et ont persuadé Mitterrand. Delors était leur garantie pour une Europe néolibérale.
Ils se trompaient complètement. Il allait bientôt devenir évident que la politique d’austérité française n’était pas une question de conviction, mais plutôt la prise de conscience que l’économie mixte keynésienne ne fonctionnait pas dans un seul pays. Mais peut-être fonctionnerait-elle dans un cadre européen, pensait Delors. Son projet était de développer une alternative aux États-Unis, qui avaient unilatéralement mis fin à Bretton Woods et, avec un dollar flottant, naviguaient librement, alternant entre un empire de production et un empire de consommation. Delors notait que les États-Unis conservaient leurs privilèges liés au dollar, mais avaient renoncé à leurs responsabilités transatlantiques qui accompagnaient la position privilégiée et prioritaire du dollar. Même en tant que ministre des Finances, il avait critiqué la situation : « Imaginez que la France puisse financer son déficit commercial en créant des francs acceptés par tous » (Bitumi 2017 : 7). Il avait brutalement pris conscience que cela n’était pas possible. Mais peut-être avec l’Europe ?
Dans un article bien documenté, Alessandra Bitumi (2017) a examiné comment Jacques Delors, qui a reçu sa formation politique au sein du mouvement ouvrier catholique, a commencé à travailler sur un discours et une politique en faveur d’une Europe sociale, en opposition aux États-Unis néolibéraux du dollar.
À ses côtés, en tant que vice-président de la nouvelle Commission en 1985, Delors avait Lord Cockfield, qui avait été ministre des Finances et du Commerce dans le gouvernement de Margaret Thatcher et qui, à partir de 1983, avait été libéré de ses responsabilités ministérielles pour agir en tant que sa personne de réflexion. Lorsque Thatcher nomma Lord Cockfield commissaire et vice-président en 1985, c’était pour renforcer ce qu’elle considérait comme le néolibéral Delors. Thatcher s’est également trompée sur Lord Cockfield, qui est devenu l’architecte du marché unique avec ses quatre libertés pour les biens, les capitaux, les services et les personnes, élément central de l’Acte unique européen adopté par la CE en février 1986, qui, comme prévu, a conduit au traité de Maastricht en 1992. En 1985, Lord Cockfield avait énuméré dans un rapport les 300 mesures nécessaires à la mise en œuvre du marché unique. Le marché unique avait une dimension sociale, une Europe sociale de marché inspirée de la doctrine sociale catholique et de la théorie sociale de marché ouest-allemande.
Le contexte était celui du discours néolibéral, qui avait toujours Friedrich Hayek comme référence principale. La définition néolibérale de la liberté (du marché) donnée par Hayek n’avait pas grand-chose à voir avec le laissez-faire. Hayek était le philosophe attitré de Thatcher, mais c’étaient davantage ses idées politiques sur le concept de liberté qui lui plaisaient que ses idées économiques, qu’elle comprenait moins bien. Selon Hayek, les libertés du marché étaient fondées sur des règles, et sur ce point, Delors et Lord Cockfield ont pu se rejoindre et éviter d’être perçus comme les architectes d’un contre-projet. La dimension sociale s’exprimerait dans la formulation des règles. Dans le même temps, l’ère Reagan a commencé aux États-Unis avec une évolution vers le laissez-faire et la déréglementation, une transition vers le capitalisme financier avec la suppression des réglementations sur les mouvements de capitaux, la privatisation des services publics, les réductions d’impôts pour les entreprises et les coupes dans la politique sociale. Les promesses de discipline budgétaire allaient de pair avec une augmentation rapide des déficits budgétaires et de la dette publique. Les contradictions entre la pratique et la rhétorique de ce qu’on appelait la « Reaganomics » étaient évidentes pour quiconque voulait les voir et contrastaient avec l’Europe que Delors voulait construire. Rien n’indique que Thatcher ait vu ce contraste. Contrairement à ses attentes, Delors, assisté de Cockfield, ne serait pas l’homme qui transformerait l’européisme en thatchérisme. On ne sait pas quand Thatcher s’est rendu compte de son erreur de jugement, mais Delors n’a rien fait pour cacher son projet. Dans ses discours et ses écrits, Delors a présenté sa vision politique et économique de l’Europe, en opposition au modèle anglo-américain d’une société atomisée et privatisée, régie par l’exigence de séparation entre l’État et le marché sous la suprématie de ce dernier, centrée sur l’individu et obsédée par l’autoréférence. La différence que Delors voyait entre l’Europe et les États-Unis concernait les différentes conceptualisations des liens entre les individus dans une communauté de valeurs et de normes (Bitumi 2017 : 10). Ces différences ont conduit à des interprétations différentes du concept de liberté, du rôle de l’État et de l’importance du marché. L’idéal normatif que Delors avait à l’esprit était de rendre le dynamisme économique compatible avec la justice sociale. Un tel ordre serait consolidé en Europe, puis s’étendrait au reste du monde, contrairement à l’ordre mondial américain qui ressemblait à un renard dans un poulailler. Avec ces projets, Delors se considérait comme un ingénieur social (Bitumi 2017 : 11). Une Europe plus intégrée rattraperait les États-Unis en matière d’innovation technologique et répondrait ainsi à ce que Servan-Schreiber avait appelé le défi américain vingt ans plus tôt (Servan-Schreiber 1967). L’Europe sociale de Delors reposait sur des principes éthiques qui motivaient des mesures de soutien financier visant à combler le fossé entre le cœur riche de l’Europe et sa périphérie plus pauvre et à résoudre le problème du chômage de longue durée.
Delors souhaitait que les droits sociaux et les normes du marché du travail fassent partie des règles du marché intérieur, une européanisation des règles par l’harmonisation. Sur ce point, il y avait un conflit évident avec Thatcher, qui s’opposait à toute cession de souveraineté nationale dans le domaine social. En 1988-1989, le conflit entre les visions néolibérales et sociales d’une Europe anglo-saxonne et d’une Europe « carolingienne » a atteint son paroxysme. Lorsqu’il est devenu évident que Thatcher ne renouvellerait pas le mandat de Lord Cockfield en tant que commissaire, Delors a prononcé un discours à Brighton en septembre 1988 à l’invitation des syndicats britanniques, dans lequel il a placé la dimension sociale au cœur de la nouvelle Europe. Delors a défié Thatcher dans son propre pays et a rejeté ses craintes d’un socialisme par la petite porte. Thatcher a répondu deux semaines plus tard depuis la tribune du Collège d’Europe à Bruges, qui était essentiellement le fief de Delors. Elle s’est concentrée sur les projets de super-État européen supranational, ce qui était un coup sur la cible, car personne n’avait préconisé une telle chose. Elle s’est distanciée d’une Europe socialiste et corporatiste, qui n’était pas non plus à l’ordre du jour. Le Wall Street Journal a commenté : « L’Amérique doit comprendre ce débat. Une défaite de la vision de Mme Thatcher serait coûteuse pour les États-Unis. Après tout, certains Américains sont enterrés aux côtés des soldats britanniques dans toute l’Europe » (Bitumi 2017:14).
Le traité de Maastricht de 1992 sur l’Union européenne, fruit des efforts de Delors, a été une réalisation importante qui a approfondi l’intégration européenne. Mais Delors n’était pas entièrement satisfait. La dimension sociale de son Europe a été transformée à Maastricht par l’opposition de Thatcher en un protocole à l’accord, mais même cela n’a pas pu être accepté par les onze et le Royaume-Uni sans que ce dernier n’émette une réserve spéciale au protocole. L’idée d’harmoniser les normes sociales planait toujours sur le débat concernant la forme que devrait prendre l’Union dans la pratique. Mais lorsque Delors a quitté la Commission en 1996, les douze gouvernements membres se sont mis d’accord sur une clause commune confirmant l’affaiblissement de la dimension sociale. Conformément à l’esprit néolibéral de l’époque, l’accord a été intégré dans le traité d’Amsterdam de 1997, qui a rejeté l’idée d’harmonisation en introduisant de nouveaux concepts tels que les méthodes ouvertes de coordination, l’analyse comparative et les meilleures pratiques, ouvrant ainsi la voie à la concurrence mutuelle entre les États membres et à une pression à la baisse sur les normes sociales. C’est cette évolution que Mario Draghi a critiquée dans son rapport sur la compétitivité de l’UE en 2024 (UE 2024). Il analyse comment l’UE peut subir une transformation structurelle, passant d’une concurrence interne au sein du marché intérieur à un rassemblement interne autour de concepts tels que l’autonomie stratégique, la compétitivité durable et la prospérité durable pour une compétitivité externe renforcée. En mettant explicitement l’accent sur la dimension sociale, il est facile de trouver un lien avec les efforts de Delors en faveur d’une Europe sociale. L’axe Delors-Draghi serait un excellent point de départ pour une réponse européenne au défi américain 2.0 incarné par Trump.
Sur la question du manque d’alternatives, du courage et de la vision d’une Europe Sociale
La politique était dictée par le marché, il n’y avait pas d’alternatives, selon un mantra néolibéral de Thatcher à Merkel. Le manque d’alternatives est au cœur de la démocratie de faible intensité qui a conduit à une crise de la démocratie libérale telle que nous la connaissons depuis les économies mixtes keynésiennes des États providence d’Europe occidentale pendant quelques décennies à partir des années 1950. Donc, dans une partie limitée du monde. Ce déclin s’est accompagné d’une montée en puissance des formes de gouvernement autocratiques et paternalistes illibérales portées par le populisme de droite. On ne sait pas exactement comment ce déclin s’est produit et comment l’expliquer, mais certains facteurs contributifs semblent clairs. L’une des principales raisons est la croyance, parce que c’était/c’est une croyance, que la politique est soumise au marché. Cette croyance, cette idéologie, est une soumission qui rend impossible toute lutte démocratique pour des alternatives et des choix dans la construction de l’avenir. La faible intensité et le passage d’une politique motivée par des intérêts et des idéologies à une recherche technocratique de maximisation des votes ont permis de croire en une politique démocratique sans alternatives.
La démocratie nécessite non seulement des alternatives guidées par l’idéologie et les intérêts, mais aussi un leadership. Il ne suffit pas de dire que la démocratie est le pouvoir du peuple, c’est-à-dire que c’est le peuple qui décide. La démocratie consiste certes à écouter le peuple, mais elle consiste tout autant à le guider vers des objectifs grâce à des visions et à des plans pour mettre en œuvre ces visions. Le leadership consiste également à trouver des compromis entre différents objectifs, car le peuple n’est pas un, mais multiple, avec des objectifs différents. Écouter, diriger, faire des compromis et gouverner sont les ingrédients d’une démocratie dynamique. Les dirigeants populistes écoutent également, mais pour gagner des voix en faveur des objectifs qu’ils définissent eux-mêmes. Les cartels de partis qui maximisent les votes écoutent, mais n’ont pas d’objectifs clairs. Ils sont guidés par ce qu’ils entendent plutôt que par ce qu’ils contrôlent. La conscience de ces distinctions s’est perdue à bien des égards. Il est important de la restaurer.
Les appels au courage en politique se multiplient. On a fait valoir que nous vivons à une époque post-héroïque (Münkler 2007). Bien sûr, il ne s’agit pas ici du courage militaire sur le champ de bataille en temps de guerre, mais du courage intellectuel nécessaire pour prendre des décisions importantes et difficiles, les assumer et faire tout son possible pour les mettre en œuvre. La démocratie a besoin de dirigeants dotés d’autorité intellectuelle, d’imagination et de charisme. Et de la capacité d’assumer la responsabilité des défaites et d’en tirer des leçons.
C’est un argument qui mérite d’être approfondi, mais qu’il est difficile de rejeter : avec le manque d’alternatives comme credo, toute une génération de politiciens a perdu le credo, l’ethos et l’habitus qui caractérisaient la politique démocratique jusqu’aux années 1980. Il semble y avoir un lien avec l’effondrement de l’ordre mondial de la guerre froide et l’euphorie déclenchée par des pensées frivoles d’un avenir sans problèmes. C’est à cette époque que le discours néolibéral sur l’absence d’alternatives sous le diktat du marché s’est également imposé. Lorsqu’il s’est effondré dans la bulle spéculative de 2008 et que la devise de l’absence d’alternatives en politique sous le marché est devenue « trop gros pour faire faillite » avec des interventions étatiques gigantesques, beaucoup se sont sentis trompés. C’est après 2008 que le populisme de droite et le paternalisme autocratique illibéral ont fait leur percée, ciblant les « cosmopolites » et les « mondialistes » néolibéraux, mais la critique du projet néolibéral avait déjà commencé aux États-Unis vers 2000, comme nous l’avons vu (Stråth 2025). La conviction qu’il n’existe aucune alternative a accompagné cette évolution et a permis à des entrepreneurs politiques entreprenants de donner à cette absence d’alternatives une forme autoritaire et nationaliste.
Cette évolution, qui semble aujourd’hui de plus en plus évidente, apparaissait beaucoup plus vague jusqu’à très récemment. Aux États-Unis, on parlait de la mort insidieuse et rampante de la démocratie (Levitsky et Ziblatt 2018). Il n’y a pas de point précis où résister. Les gens suivent, avec un sentiment désagréable dans un paysage crépusculaire, sans savoir quoi faire jusqu’à ce que tout bascule et qu’il soit trop tard, lorsque la pente déclenche l’avalanche. C’est là où se trouvaient les États-Unis en janvier 2025. C’est contre cette évolution que Habermas met en garde (Habermas 2025 ; cf. Stråth 2025) Anglais et exhorte les dirigeants européens à se lever et à l’arrêter avant qu’elle n’aille trop loin. Trump n’a pas de motivations charitables, seulement ses propres intérêts, qu’il définit d’une manière à la fois cynique et énigmatique. Il y a un écart entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Mais ce serait une grave erreur de considérer Trump comme un phénomène typiquement américain qui ne peut se produire en Europe. L’administration Trump et les oligarques de la technologie sont engagés dans quelque chose de très important, à savoir une restructuration de l’ordre mondial par une expansion systématique et délibérée du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir parlementaire. Que les plans de restructuration, qui ne sont pas nécessairement très concrets ni soutenus à l’unanimité par les dirigeants, aboutissent ou aboutissent à une anarchie mondiale, l’Europe et les conditions de la démocratie en Europe seront fortement affectées.
En l’absence de recherches systématiques, il s’agit davantage d’une hypothèse que d’un argument : les politiciens qui n’offrent aucune alternative sont devenus les apôtres de l’impuissance. Le centre politique, qui n’offre aucune alternative, est devenu le centre de l’impuissance, où tout le monde se presse sans vouloir remarquer qu’il est tiré vers la droite, là où se déroule la politique créative. Ils ne remarquent pas, ou ne veulent pas remarquer, que la créativité va dans la mauvaise direction. Un nouveau centre est nécessaire, avec des conflits et des compromis d’idées et d’intérêts entre les alternatives social-démocrates, socio-libérales et socio-conservatrices. La question de la distribution doit à nouveau être abordée comme le conflit qu’elle représente, dans le but de trouver des compromis. Le mythe selon lequel le marché résout automatiquement et harmonieusement le conflit pour tout le monde doit être rejeté. Le conflit sur la distribution doit à nouveau pouvoir faire impression, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Il n’est plus possible de prétendre qu’il n’existe pas. Un nouveau terrain d’entente doit être créé, s’éloignant du néolibéralisme qui s’est effondré et n’a plus rien à offrir que des perturbations, sans se soucier de ce qui se passera après la destruction ou de ce qui doit être détruit exactement et pourquoi. Un nouveau juste milieu qui se distancie également du travail du nationalisme social qui fait de l’histoire son avenir, où les bâtisseurs de droite ferment les yeux sur la facilité avec laquelle le nationalisme social se transforme en national-socialisme, soit en fermant les yeux, soit en le souhaitant.
La distinction entre consommation et investissement a été perdue dans la doctrine budgétaire qui survit depuis l’ère Reagan. Selon cette idéologie, les réductions d’impôts pour les tranches de revenus supérieures stimulent l’économie et relancent la machine lorsqu’elle menace de s’arrêter. Cette doctrine était la réponse des économistes partisans de l’offre à la stimulation de la demande keynésienne, qui avait une ambition politique distributive. La question de la distribution est également présente dans le reaganisme, mais pas en tant que problème, plutôt comme un bonus, non pas de haut en bas, mais de bas en haut, comme l’a montré Thomas Piketty (2013) de manière très détaillée. Le reaganisme a résolu et résout le problème de la distribution avec la théorie du fumier de cheval : quelques grains d’avoine sont laissés aux moineaux, les pauvres. Dans une métaphore plus appétissante, cette idée est appelée « trickle down » (ruissellement). Keynes avait compris la différence entre stimuler la demande dans une économie en déclin et stimuler l’inflation si la méthode était utilisée pour résoudre des problèmes structurels. Lorsque les disciples de Keynes n’ont pas compris cela pendant la crise structurelle des années 1970, le phénomène de stagflation est apparu, ce qui a été une surprise. Les penseurs néolibéraux ont également perdu de vue la distinction entre cycle économique et structure lorsqu’ils plaident en faveur de réductions d’impôts. Ils ignorent la différence entre consommation et investissement lorsqu’ils soulignent la nécessité d’un budget équilibré en toutes circonstances. Si les réductions d’impôts entraînent des déficits, celles-ci sont qualifiées de temporaires. À long terme, les réductions d’impôts s’autofinanceront, affirment-ils. Ces questions doivent être débattues à nouveau en exposant les contradictions fondamentales. Il s’agit là d’une condition préalable importante pour une démocratie dynamique.
Une nouvelle théorie économique est nécessaire pour résoudre les grands problèmes existentiels liés au climat et à l’environnement, ainsi qu’à la répartition mondiale des ressources et des revenus de la planète. Il ne s’agit pas de réinventer la roue, mais de repenser les anciennes questions. L’économiste Mariana Mazzucato (2021) souhaite changer les fondements économiques de l’absence actuelle d’action politique et de gouvernance en matière d’économie. Son livre Mission Economy présente de manière passionnée et convaincante une nouvelle vision de la politique et de l’économie qui laisse derrière elle le néolibéralisme et son absence d’alternatives. Son étude de cas porte sur le satellite espion russe Spoutnik en 1957, qui a provoqué une onde de choc aux États-Unis et conduit à la mise en place du projet Apollo par l’administration Kennedy, basé sur la décision d’envoyer un homme sur la Lune dans les dix ans. Mazzucato décrit comment l’administration a pris la tête du projet, mobilisé et coordonné l’industrie, les instituts de recherche et les médias, discuté des objectifs intermédiaires sans contrôle hiérarchique et incité tout le monde à travailler à la réalisation de l’objectif. Le point essentiel était le leadership politique qui a suscité l’engagement de la base. Elle montre que l’industrie et l’économie ne sont pas seulement une question de profits pour les actionnaires, mais qu’il y avait aussi des intérêts publics avec diverses parties prenantes, par opposition aux actionnaires. La coordination politique consistait en partie à faire concilier ces intérêts. Cette coordination nécessite une réflexion à long terme qui doit être constamment gardée à l’esprit et actualisée. Le modèle de Mazzucato imprègne l’économie de visions, d’organisation, d’ambitions et d’intérêt public, des qualités qui ont disparu dans l’économie monétaire des intérêts à court terme et de la spéculation. Au lieu de faire d’un espace budgétaire fixe imaginaire le point de départ de la politique, Mazzucato préconise de partir d’une vision de l’avenir et de la politique à mettre en œuvre pour réaliser cette vision, puis de créer à partir de là l’espace financier nécessaire à l’objectif politique. Comme pour le projet Apollo. Le modèle et la réflexion qui le sous-tendent s’inscrivent très bien dans le travail de Delors pour une Europe sociale. Le défi posé par le livre de Mazzucato est de savoir pourquoi les grands projets ont si souvent une origine et un objectif militaires. Pourquoi sont-ils si souvent liés à des questions existentielles majeures liées aux armes ? Une Europe sociale et une planète avec un climat propice à la survie sont également des questions hautement existentielles. Le livre de Mazzucato a disparu beaucoup trop facilement et trop rapidement pendant la pandémie. Il mérite d’être pris très au sérieux à travers un débat approfondi sur la manière dont ses idées peuvent être concrétisées. Si les idées de ce livre devenaient courantes, des propositions plus radicales pour l’économie de demain pourraient également faire leur apparition dans l’arène publique (Quilligan et Stråth 2025).
Le moralisme n’est pas un bon principe pour l’action politique, mais à l’ère du marché nihiliste, sans alternative, on a oublié que sans valeurs éthiques et morales, sans normes, sans politique fondée sur des règles, la politique démocratique ne fonctionnent pas. Jacques Delors le savait dans son travail sur l’Europe sociale. Il a osé esquisser et défendre une grande vision. Il a osé prendre la responsabilité d’une politique qui corrigeait et complétait une Europe purement axée sur le marché. Il voulait créer une Europe qui soit plus qu’un système à la carte où chacun choisissait les avantages qui lui convenaient, mais ne voulait pas faire partie des compromis et des sacrifices nécessaires pour former une Europe commune. Pour empêcher l’évolution que le régime Trump a encouragée, un ordre mondial éloigné de celui d’aujourd’hui vers quelque chose d’autre, qu’il aboutisse à l’anarchie mondiale ou au triomphe des algorithmes, une Europe différente est nécessaire. Une Europe différente dont les dirigeants assument leurs responsabilités les uns envers les autres dans ce qui est une communauté européenne de destin. Si les pays du nord pensent que la défense contre la menace à l’est est importante, ils doivent se demander ce qui peut faire en sorte que des membres tels que l’Italie, l’Espagne et le Portugal se sentent impliqués. Une politique commune en matière de réfugiés et d’immigration, avec une responsabilité conjointe pour ce que l’on appelle Schengen, serait peut-être une possibilité. Mais il faudrait une politique en matière de réfugiés et d’immigration fondée sur des valeurs, d’un tout autre type que celle qui est actuellement pratiquée. Cela nécessite à son tour des dirigeants qui osent penser de manière visionnaire et assumer la responsabilité de leurs idées. Dans ce contexte, Delors, avec l’aide de Mario Draghi, pourrait servir de modèle pour la construction d’une Europe qui assume une responsabilité mondiale et planétaire pour elle-même et pour le monde, d’une manière différente de celle des puissances européennes sous les concepts de colonialisme et d’impérialisme. En d’autres termes, l’Europe comme contrepoint aux États-Unis d’aujourd’hui. Un troisième article intitulé « Un ordre mondial en dissolution » développera cette idée.
En fin de compte, la question du jour est celle du leadership. À une époque où les idéaux autocratiques et paternalistes semblent caractériser le style de leadership, il serait important d’avoir un débat sur les valeurs et les normes basé sur deux problèmes : la question de la coexistence décente sur la planète Terre et les possibilités et les risques des algorithmes, ainsi que, bien sûr, le pouvoir sur ceux-ci. Élargir le débat dans cette direction conduit automatiquement à un lien avec la question existentielle du climat et de l’environnement. La question fondamentale est, bien sûr, de savoir si la démocratie peut être sauvée. Il s’agit d’essayer de voir le monde tel qu’il est sans oublier la question de penser comment il devrait être. Le point de départ doit être la prise de conscience que l’histoire n’est pas prédéterminée, mais qu’elle est créée par l’action ou l’inaction humaine. La tâche consiste à développer de nouvelles perspectives et un nouveau discours sur l’avenir, loin du manque d’alternatives et des diktats du marché. Le discours crée le cadre de l’action. Le leadership suit le discours tout en le créant et en le développant.
Traduction par DeepL et Bo Stråth de l’article Bo Stråth, “En världsordning i upplösning. Vad nu? 2. Den lågintensiva demokratin utan alternativ, nihilismen och algoritmerna.” Statsvetenskaplig Tidskrift Vol 128 Nr 3 Septembre 2025.
Note de fin
[1] Meloni pourrait représenter un nouveau style politique qui comble le fossé entre le conservatisme libéral modéré et le populisme de droite. Malgré ses origines dans le mouvement néofasciste, elle ne suit pas vraiment le modèle autoritaire et paternaliste du populisme de droite, même si certains signes vont dans ce sens, comme la restructuration de la RAI, la chaîne publique de radio et de télévision. Elle ne forme pas de front uni avec le leader de la Ligue, Matteo Salvini, dont le parti populiste de droite fait partie de la base gouvernementale, comme en témoignent sa position plus modérée que celle de Salvini sur l’immigration et sa prise de distance par rapport au leader de la Ligue, favorable à Poutine, à travers son soutien à l’Ukraine. Elle garde Salvini à distance. La question est de savoir si elle cherche réellement à combler le vide créé par l’effondrement du Parti démocrate-chrétien italien dans les années 1990, un vide que Berlusconi a également tenté de combler sans vraiment y parvenir. De même, Meloni oscille entre la droite modérée et l’extrême droite en Europe. Cet exemple montre à quel point la politique de droite est complexe. Il est clair que le centre de gravité politique s’est déplacé vers la droite, mais les implications ne sont pas aussi évidentes.
À suivre :
« Un ordre mondial en dissolution. Et maintenant ? 3. Une Europe fondée sur des valeurs à l’ère du nihilisme. Vers un nomos pour une société mondiale. » Décembre 2025
Références:
Arrighi, Giovanni, 2010. « The World Economy and the Cold War, 1970-1990 », dans Leffler, Melvyn P. & Westad, Odd A., (éd.) The Cambridge History of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, vol. 3 : 49. Cité dans Bitumi 2017 : 8.
Balibar, Etienne, 2025. « L’impossible possibilité de la fédération européenne : hier, aujourd’hui, demain » Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/limpossible-possibilite-de-la-federation-europeenne/ Published 06.07.2025
Bitumi, Alessandra, 2017. « Narrating Social Europe. The Search for Progress in the ‘Age of Delors’ ». Notre Europe Policy Paper, 27 janvier.
Clark, Christopher, 2025. « Ist Trump Faschist? ». Süddeutsche Zeitung, 27 juin.
Crouch, Colin, 2009. « Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Regime », The British Journal of Politics and International Relations 11(3), pp. 382-399.
Crozier, Michel J., Huntington, Samuel P. & Watanuki, Joji, 1975. The Crisis of Democracy Report on the Governability of Democracy to the Trilateral Commission. New York : New York University Press.
van Eeden, Pepijn, 2019. « Discover, Instrumentalize, Monopolize: Fidesz’s Three-step Blueprint for a Populist Take-over of Referendums », East European Politics and Societies 33(3), p. 3.
Da Empoli, Giuliano, 2025. L’heure des prédateurs. Paris : Gallimard.
UE, 2024. Le rapport Draghi. A et B. Bruxelles : Commission européenne.
Gustavsson, Rolf, 2010. Sveriges statsministrar under 100 år: Ingvar Carlsson. Stockholm : Albert Bonniers.
Habermas, Jürgen, 2025. « Für Europa », Süddeutsche Zeitung, 21 mars 2025.
Hanson, Stephen E. & Kopstein, Jeffrey S., 2024. The Assault on the State. How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future. Cambridge : Polity Press.
Hartog, François, 2003. Des régimes d’historicité : Présentisme et expériences du temps. Paris : Seuil.
Lang, Andrew, 2011. World Trade Law After Neoliberalism: Re-Imaging the Global Economic Order. Oxford : OUP
Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel, 2018. This is how democracies die. Penguin Books.
Lewis, Michael, 2018. The Fifth Risk: Undoing Democracy. WW Norton & Company.
Mair, Peter, 2013. Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy. Londres : Verso.
Marks, Susan, 2000. The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology. Oxford : Oxford University Press.
Mazzucato, Mariana, 2021. Mission Economy. A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Londres : Allen Lane.
Moyn, Samuel, 2010. The Last Utopia. Human Rights in History. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Moyn, Samuel, 2018. Not Enough: Human Rights in an Unequal World. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Münkler, Herfried, 2007. « Heroische und postheroische Gesellschaften », Merkur n° 700, septembre.
Quilligan, James & Stråth, Bo, 2025. « The Value of Energy. Trois conversations entre Bo Stråth et James Quilligan ». Blog https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/the-value-of-energy-conversations-with-james-quilligan Publié le 04.01.2025.
Piketty, Thomas, 2013. Le Capital au XXIe siècle. Paris : Seuil.
Rodrik, Dani, 2000. « How Far Will International Economic Integration Go? Journal of Economic Perspectives 14, pp. 177-186.
Servan-Schreiber, Jean-Jacques, 1967. Le défi américain. Paris : Versilio.
Stråth, Bo, 2023. The Brandt Commission and the Multinationals. Planetary Perspectives. Londres: Routledge.
Stråth, Bo, 2024. « Where did the future go, and can it be reshaped? » Blog https://bostrath.com/planetary-perspectives/ordering-of-space-and-time/where-did-the-future-go/ Publié le 17.09.2024.
Stråth, Bo, 2025. « Un ordre mondiale en pleine dissolution. Et maintenant ? 1. La rencontre des empires en Europe et la réponse de l’Europe ». Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/un-ordre-mondial-en-dissolution-et-maintenant/ Published 06.07.2025
Stråth, Bo & Trüper, Henning, 2025. « Conceptualiser le capitalisme : conversations avec Henning Trüper. Blog 4. L’esprit du temps de l’empire et du nihilisme dans une perspective historique. Et le capitalisme ? » https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/conceptualizing.
Varoufakis, Yanis, 2011. Global Minotaur: America, Europe and the Future of Global Economy. Londres : Zed Books.
Wilentz, Sean, 2000. The Age of Reagan, 1974-2008. New York : Harper Collins.
Comment citer:
Cit. Bo Stråth, “Un ordre mondial en dissolution. Et maintenant ? 2. Une démocratie de faible intensité sans alternatives, le nihilisme et les algorithmes.” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/un-ordre-mondial-en-dissolution-et-maintenant-2/ Published 24.09.2025
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.