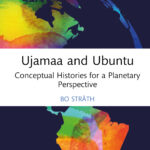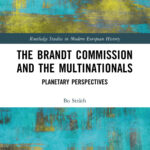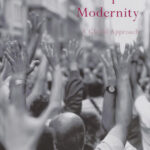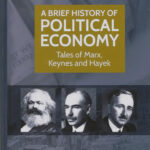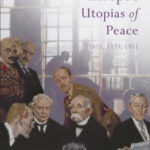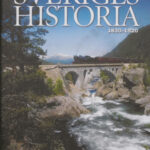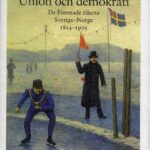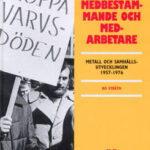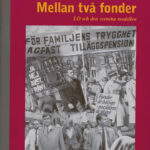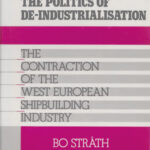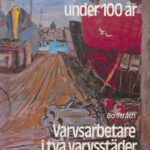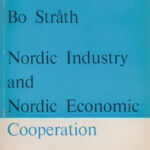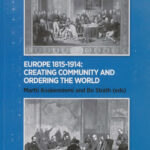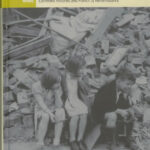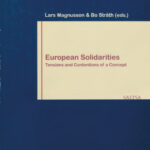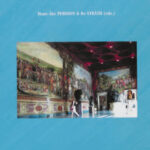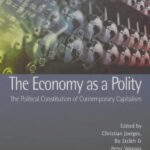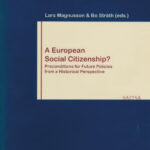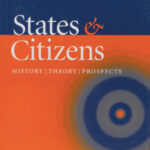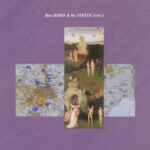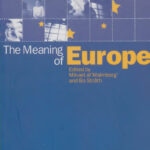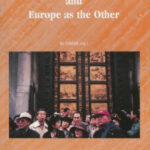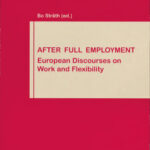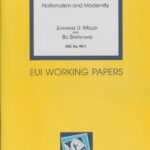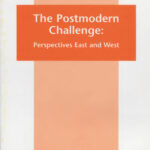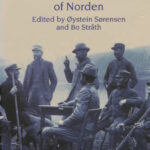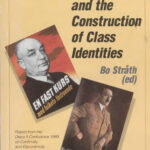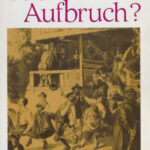Les relations transatlantiques : un bref historique depuis 1945
En 1945, les États-Unis sont apparus comme la première puissance mondiale. Contrairement à ce qui s’était passé après la Première Guerre mondiale, le président et le Congrès ont alors conclu que le pays était une puissance mondiale et ont agi en conséquence. Très vite, l’Union soviétique s’est imposée comme un challenger, et les États-Unis ont relevé le défi. Dans un contexte où les empires européens s’étaient détruits eux-mêmes, les deux empires restants se sont partagé l’Europe. Le plan Marshall de 1947 a ouvert une nouvelle phase dans les relations transatlantiques, plus intense qu’auparavant et avec des revendications américaines beaucoup plus claires en matière de leadership, le tout dans le contexte de la guerre froide. L’alliance militaire de l’OTAN, avec la participation de l’Allemagne de l’Ouest à partir de 1955, a souligné l’importance militaire dans les relations. La guerre de Corée de 1950-1953 les a renforcées pendant l’impasse nucléaire des années 1950.
Cependant, après les crises connexes du Congo, de Berlin et de Cuba de 1960-1962, qui, rétrospectivement, semblent avoir été l’aboutissement de la menace nucléaire, elles n’ont jamais été harmonieuses pendant une longue période. Charles de Gaulle se méfiait ouvertement du dollar comme monnaie mondiale et des États-Unis comme puissance mondiale. La France a quitté le volet militaire de l’OTAN. L’abandon de l’étalon-or du dollar en 1971-1973 a encore perturbé les relations. L’euphorie qui a suivi la chute de l’Union soviétique a modifié les conditions de la coopération transatlantique. La perspective mondiale est passée au premier plan. Cela n’a pas changé en principe lorsque le 11 septembre 2001 a mis fin au rêve de la fin de l’histoire et d’un monde libéral unique tel qu’envisagé par Francis Fukuyama (1992). Samuel Huntington (1996) avait déjà rejeté la vision du monde de Fukuyama quelques années auparavant, lorsqu’il avait décrit l’avenir comme un choc des civilisations. L’attaque contre les tours jumelles semblait confirmer la thèse de Huntington et a donné lieu à une vague néoconservatrice moraliste avec une lutte pour la démocratie et les valeurs occidentales à travers le monde. La guerre en Irak en 2003 a été le point culminant de la campagne qui a divisé la coopération européenne. Comme on le sait, cette guerre a été justifiée par des mensonges. Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld a divisé l’Europe de manière impérieuse entre l’ancienne Europe, qui refusait de participer à la guerre, et la nouvelle Europe, qui s’est jointe à la chasse à Hussein dans la « coalition des volontaires ». Le livre de Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (2003), qui comparait les États-Unis à Mars et l’Europe à Vénus, a donné expression aux fortes tensions transatlantiques qui se sont propagées au sein même de l’Europe. Officiellement, l’OTAN n’était pas impliquée. Cependant, pendant cette période troublée avec des tensions transatlantiques, une détente entre la Russie et l’Ouest semblait s’installer. La nouvelle Russie était liée à l’OTAN par le Partenariat pour la paix en 1994 et le Conseil OTAN-Russie en 2002. Pendant cette période de compréhension mutuelle dans les relations avec la Russie, l’OTAN est devenue de plus en plus une force internationale d’intervention policière et militaire musclée dans les conflits locaux à l’échelle mondiale et de moins en moins une force de défense contre les invasions. Dans le cadre de cette compréhension mutuelle, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont adhéré à l’OTAN en 1999. Les États baltes, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Slovénie ont suivi en 2004, la même année où la plupart des pays d’Europe de l’Est sont devenus membres de l’UE. L’esprit de consensus qui a présidé à cette expansion de l’OTAN a été de courte durée. La Russie entretenait des relations compliquées avec la Géorgie depuis l’effondrement de l’Empire soviétique. Un mouvement puissant en Géorgie souhaitait rapprocher le pays de l’Occident, de l’UE et de l’OTAN. Avec le président Saakashvili, clairement orienté vers l’Occident, ce mouvement a pris un visage. Les ambitions de plus en plus affirmées du président ont eu un impact négatif sur les relations entre l’OTAN et la Russie, qui se sont sensiblement détériorées à partir de 2006. En février 2007, Poutine a prononcé un discours très remarqué lors de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich, dans lequel il a clairement pris ses distances avec le nouvel ordre mondial, qu’il a qualifié de monopolistique. Il était clair qu’il accusait les États-Unis d’avoir des ambitions monopolistiques. En mai 2007, les États-Unis ont entamé des négociations avec les gouvernements de Varsovie et de Prague au sujet du déploiement de missiles en Pologne et d’installations radar associées en République tchèque. Les projets de la Géorgie d’adhérer à l’OTAN ont conduit à la guerre de 2008 en Géorgie. Les manifestations de l’Euromaidan en Ukraine, de novembre 2013 à février 2014, étaient une protestation contre la décision du gouvernement pro-russe de ne pas signer un accord d’association avec l’UE. Les manifestations se sont terminées par la fuite du président et la réponse de la Russie par une infiltration militaire dans le Donbass et l’annexion de la Crimée.
Les tensions croissantes entre la Russie et l’OTAN au sujet du pouvoir dans le Caucase et en Ukraine ont temporairement renforcé les relations transatlantiques après 2014. Mais avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche de 2017 à 2021, les tensions ont de nouveau augmenté, notamment au sujet du financement de la coopération militaire, où les États-Unis étaient initialement le bailleur de fonds le plus clair. L’attaque de la Russie contre l’Ukraine en février 2022 a renforcé l’esprit de coopération, mais avec le retour au pouvoir de Trump en janvier 2025, le fossé atlantique s’est creusé plus que jamais, tandis que Trump se rapprochait de la Russie.
L’ordre occidental centré sur les États-Unis après 1945 est mort. Depuis 1949, la pierre angulaire de cet ordre est l’OTAN, qui est plus centrale que les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. L’essence même de l’OTAN réside dans l’article 5 sur l’assistance mutuelle. En cas d’urgence, cet article ne peut être testé juridiquement, mais il est moral et fondé sur la confiance mutuelle. Trump a sapé cette confiance en faisant de cet article une question de savoir si le régime Trump considère que les membres européens ont suffisamment payé pour leur défense. Il est clair depuis 2014, et depuis février 2022, cela a été souligné avec force, que la menace de l’OTAN est la Russie. Cela est dit sans entrer dans la question très controversée de savoir si l’OTAN, du point de vue de la Russie après 1990, constituait une menace pour la Russie, mais en observant que ce débat ne justifie en aucun cas l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Après la guerre d’agression à grande échelle de février 2022, l’OTAN a été de plus en plus réactivée dans la réflexion et la planification stratégiques en tant que défense contre l’invasion, ce qu’elle était depuis le début. Le rapprochement de Trump avec la Russie dans le dos de l’Europe a, plus encore que la controverse financière sur le montant des dépenses de défense, souligné la désintégration de ce qu’on appelait l’Occident. L’OTAN continue officiellement d’exister, mais l’Europe ne partage pas l’évaluation de la menace faite par les États-Unis.
La situation au printemps 2025
Depuis la deuxième investiture de Trump, de nombreux commentaires ont analysé la désintégration de l’ordre mondial et cherché des explications à court et à long terme, tant chez Trump lui-même qu’au-delà. L’objectif ici n’est pas de résumer le débat, mais d’identifier quelques lignes d’argumentation qui serviront de base à une discussion sur ce qui se passe et pourquoi. Il est ironique que la communauté qui s’est construite autour du concept d’Occident, créé par un président américain il y a près de 80 ans, soit aujourd’hui déchirée par un autre président américain. Un ordre mondial transatlantique vieux de près de 80 ans – ni plus, ni moins – une histoire qui va de Truman à Trump est en train d’être détruite, délibérément, momentanément et à coups de marteau. En gouvernant par décrets présidentiels et déclarations publiques, souvent courtes et radicales sur les réseaux sociaux, Trump façonne l’opinion publique et crée des faits qui contournent le Congrès et défient de manière provocante les décisions de justice. La politique accélère et simplifie des contextes complexes. Elle suscite des émotions fortes et devient polémique. Il s’agit de retrouver la grandeur perdue des États-Unis (MAGA, Make America Great Again). La Chine et l’Europe/l’UE sont présentées comme les principales causes. Si la Chine est traitée avec un certain respect rhétorique, les critiques à l’égard de l’Europe sont plus virulentes. La salve d’ouverture du vice-président J. D. Vance lors de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich le 14 février 2025 (Maison Blanche, 14/02/2025) a suscité étonnement, choc et colère en Europe. Dans un style conflictuel, Vance a affirmé que l’Europe n’était pas suffisamment démocratique. Deux éléments en particulier distinguent l’Europe des États-Unis en tant que modèle, et il a exigé des améliorations dans ces domaines. L’Europe traite mal les partis populistes de droite. Ceux-ci doivent être clairement et sans ambiguïté intégrés dans la politique parlementaire. Le deuxième point concernait les restrictions à la liberté des plateformes numériques. Ces restrictions sont l’expression de lacunes antidémocratiques en matière de liberté d’expression qui doivent être corrigées. Les revendications territoriales répétées de Trump sur le Groenland, le Canada et le canal de Panama, accompagnées de menaces d’annexion, constituaient un défi ouvert au droit international qui renforçait l’impression d’une volonté de rompre avec l’ordre mondial en place depuis 1945. Dans deux cas, ces revendications visaient des pays membres de l’OTAN depuis sa création en 1949.
Dans un discours prononcé le 7 avril 2025, Stephen Miran, conseiller économique de Trump, a clarifié l’enjeu de la lutte pour le MAGA. Les États-Unis fournissent deux biens publics mondiaux : un parapluie de sécurité surveillé par l’armée américaine et le dollar, avec les obligations du gouvernement américain en son centre, autour duquel gravite le système financier international. Ces deux biens sont coûteux pour les États-Unis, et le président a voulu clairement faire savoir que les États-Unis ne sont plus disposés à payer pour le parasitisme des autres nations (déclaration de la Maison Blanche, 7 avril 2025). L’aspect sécuritaire a été exprimé dans l’affirmation selon laquelle les membres européens de l’OTAN ne paient pas leur juste part des coûts de défense, qui, selon Trump, s’élève à 5 % du PIB. Il s’exprime parfois comme si cela faisait référence aux contributions des membres de l’OTAN au budget de l’organisation, alors que ce chiffre correspond en réalité à leurs dépenses de défense en pourcentage de leur PNB, où le consensus est de 2 %. Il a clairement indiqué que les membres qui ne paient pas suffisamment ne peuvent pas compter sur le soutien actif des États-Unis en cas de guerre. Avec son rapprochement ostentatoire avec la Russie sous le couvert d’un rôle de médiateur autoproclamé (dans la guerre en Ukraine), Trump a sapé la confiance dans l’alliance encore plus que par les doutes qu’il a semés sur l’article 5. Trump a fait vaciller l’ensemble de l’alliance. Le fossé en matière de politique de sécurité est aggravé par celui en matière de politique commerciale que Trump creuse par des droits de douane grotesques. Les règles ne s’appliquent plus. La politique internationale fondée sur des règles, le droit international et le droit commercial cède la place à l’arbitraire de la politique de puissance. Les nouveaux droits de douane marquent une rupture démonstrative avec l’ordre mondial néolibéral construit depuis les années 1980 autour de l’idée d’un commerce mondial libre, où la production est délocalisée vers les chaînes d’approvisionnement mondiales les moins chères, où la précision des délais remplace les coûts élevés de stockage et où les salaires et les normes sociales sont tirés vers le bas.
Le protectionnisme revient en force pour la première fois depuis les années 1930, et les arguments avancés par l’administration Trump rappellent le mercantilisme. Dans son discours du 7 avril, le conseiller du président Trump, Miran, a clairement expliqué l’objectif des droits de douane : contraindre les autres pays à payer un tribut pour maintenir l’empire américain. Les engagements financiers obligent les États-Unis à taxer injustement les Américains qui travaillent dur, une déclaration qui suggère que les recettes provenant des droits de douane créent une marge de manœuvre pour réduire les impôts. Mais l’idée est également de contraindre les entreprises industrielles à délocaliser leur production aux États-Unis. Le dollar, en tant que monnaie mondiale, a entraîné des distorsions des taux de change, qui ont à leur tour créé des barrières commerciales déloyales et, à long terme, des excédents commerciaux insoutenables vis-à-vis des États-Unis. Cet argument s’applique au commerce des biens, mais ignore les importants excédents commerciaux américains dans le domaine des services, créés par les géants de la technologie numérique.
Les deux domaines problématiques, la sécurité et la politique commerciale, sont polarisés par l’image sans vergogne de l’Europe dressée par le régime Trump, dans laquelle les Européens sont des profiteurs et des parasites des États-Unis. Ce sont des resquilleurs. La Chine est soumise à la même caricature, mais les émotions semblent plus vives lorsqu’il s’agit de l’Europe. L’intégration européenne, qui a abouti à l’UE, a été créée pour nuire aux États-Unis. Le président n’apporte aucune preuve à l’appui de cette thèse. Au sein de l’OTAN, les Européens ne contribuent pas financièrement à hauteur de leur poids et, dans le domaine commercial, ils exploitent injustement les États-Unis. L’Europe apparaît non seulement comme une caricature, mais aussi comme un ennemi déclaré.
La conclusion est claire : l’Occident tel qu’il a émergé après 1945 n’existe plus. Le régime Trump développe une image ennemie dans laquelle la cause de tous les maux réside en Europe. Dans un essai, Fintan O’Toole développe ses réflexions sur l’europhobie de Trump (O’Toole 2025). Bien que la perception de la réalité de Trump soit instable et en constante évolution, il a des idées fixes et des instincts immuables. Ce sont ces obsessions et ces instincts qui remodèlent aujourd’hui les relations entre les États-Unis et l’Europe de manière plus spectaculaire qu’à aucun moment depuis 1945. Trump ne se détourne pas de l’Europe, il la piétine. Son régime n’a pas perdu tout intérêt pour l’Europe. Il a développé un intérêt malveillant pour la destruction de l’UE, écrit O’Toole. L’hostilité de Trump envers l’UE s’est d’abord manifestée par son soutien enthousiaste au Brexit. Au cours de son premier mandat, sa conviction que l’UE est un « ennemi » au même titre que la Chine a refait surface de temps à autre, mais cette idée est restée latente dans l’ensemble. Aujourd’hui, l’intérêt n’est plus de laisser l’Europe à son sort, mais de saper et de remodeler l’UE de l’intérieur en soutenant ouvertement les partis populistes et extrémistes de droite, comme l’ont exprimé Musk, Vance, Rubio et d’autres. L’UE ne peut plus simplement supposer que les États-Unis sont bienveillants, elle doit partir du principe qu’une hostilité active pourrait se développer de concert ou en coopération avec la Russie.
Le gros problème est que le régime Trump n’intervient pas seulement dans des domaines politiques spécifiques, mais s’attaque au système même des normes qui entourent des concepts tels que l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Trump suit Poutine. Cela a des conséquences tangibles, en particulier dans les relations internationales, où il n’y a pas de Léviathan, pas de puissance protectrice qui défend les normes et les règles par la force policière et militaire. Trump s’attaque à la norme de la liberté de la recherche et donne des instructions détaillées aux universités menacées. Il affiche son mépris pour les connaissances scientifiques.
Le langage qui a commencé avec les fausses nouvelles et la fausse vérité ou la vérité alternative pendant le premier mandat s’éloigne de plus en plus de ce qu’on appelait autrefois le fondement de la raison. La recherche scientifique de connaissances objectives – combinée à la prise de conscience que l’objectif peut être considéré sous plusieurs angles et que les préjugés idéologiques peuvent brouiller la recherche – est sapée et la chasse aux sorcières renaît. La raison critique de Kant en tant que principe académique d’action est rejetée. L’intention est peut-être de créer une base pour remplacer les idées du philosophe par l’intelligence artificielle produite par les géants de la technologie.
Le langage se radicalise non seulement au sens orwellien, où la guerre est appelée paix et la paix est appelée guerre, mais aussi en devenant plus polarisé et émotionnel. L’immigration est qualifiée d’invasion. L’émigration devient remigration et déportation. Il convient de noter que cette évolution linguistique est la même en Europe, où la question de l’immigration des deux côtés de l’Atlantique devient un catalyseur, un sujet de substitution pour toute une série d’autres problèmes sociaux, qui peuvent être résumés brièvement en deux points : les problèmes socio-économiques consécutifs aux ravages du néolibéralisme et à son effondrement dans la bulle spéculative de 2008, et le changement climatique. Le langage devient plus excessif. Nous manquons d’un langage qui décrit le nouveau monde comme la différence qu’il représente par rapport à la démocratie qui était la norme. Ses concepts utilisent la norme démocratique, mais ils ne correspondent pas (Stråth & Trüper 2025). L’Europe s’accroche aux idéaux auxquels elle croyait et continue d’utiliser les expressions qui ont façonné ces idéaux au lieu de décrire le changement. L’Europe veut croire qu’elle est toujours à l’apogée de la démocratie, à une époque où celle-ci était considérée comme acquise pour toujours. L’Europe se voit comme le contrepoint au fanatisme et au culte du leadership qui régissent les États-Unis, sous l’emprise d’intérêts puissants alliés à des algorithmes. Il est vital pour l’Europe de prendre conscience des risques que la révolution numérique fait peser sur la démocratie en Europe également, et de créer un langage qui permette de décrire ces risques. Quel type de sphère publique les réseaux sociaux constituent-ils par rapport aux sphères publiques qui ont soutenu les démocraties dans les années 1950 et 1960 ? La distinction entre public et privé, que Thomas Hobbes a proposée aux dirigeants il y a près de 400 ans afin de mettre fin à des décennies de guerres de religion en Europe, est en train de s’effriter à mesure que le privé devient public sur les réseaux sociaux. Cette renonciation volontaire à la vie privée modifie les conditions de la critique sociale et du contrôle gouvernemental. Les émotions qui bouillonnent et les simplifications qui détruisent des valeurs complexes infantilisent et brutalisent le débat public. Il est vital pour l’Europe de prendre le contrôle des algorithmes et de les réglementer pour sauver la démocratie. Rapidement.
Bien que le conflit entre les États-Unis et l’Europe soit le principal problème, il est important de rappeler que l’Europe est dangereusement proche des États-Unis dans l’évolution qui cause tant de perturbations, à savoir l’émotionalisation et l’infantilisation du débat public. Il ne faut pas surestimer les différences entre les États-Unis et l’Europe en termes d’intensité des réseaux sociaux. On pourrait parler d’un point de basculement européen proche, où tout évolue dans le sens américain. L’Europe aimerait être un bastion des valeurs, mais elle ne l’est pas. Nous devons nous appuyer sur cette constatation.
Un ordre mondial en dissolution. Et maintenant ?
Les signes d’un changement aux États-Unis sont apparus dès la guerre en Irak, et un renversement de tendance s’est produit avec l’élection de Donald Trump à la présidence en 2016, que les dirigeants européens ne voulaient pas voir et espéraient plutôt que son mandat serait temporaire et qu’il serait ouvert au dialogue pendant son mandat. En 2020, avec l’élection de Joe Biden, ils considéraient Donald Trump comme une note de bas de page de l’histoire. Aujourd’hui, nous savons que Biden n’était qu’une parenthèse. Dans le débat européen qui a précédé l’élection présidentielle de l’automne 2024, tout le monde prétendait se préparer au retour de Trump, mais cette préparation consistait davantage à se convaincre, sans analyse approfondie, que Trump serait le même que la dernière fois et que la solution consistait à trouver un accord en le flattant. Au cours de l’automne, les préparatifs pour Trump se sont davantage orientés vers des espoirs placés en Harris. Personne parmi les responsables n’avait imaginé le Trump qui est revenu, et encore moins ses actions sur la question ukrainienne. Tout le monde a été pris au dépourvu par sa détermination, soutenue par les oligarques de la technologie, avec ou sans tronçonneuses.
Avec une grande autorité intellectuelle, Jürgen Habermas a décrit cette rupture en termes forts dans un article de journal publié en mars 2025 (Habermas 2025). Il parle d’une rupture historique qui a des conséquences profondes pour l’Europe. Si l’UE ne parvient pas à trouver une réponse convaincante, l’Europe sera entraînée dans le tourbillon provoqué par la superpuissance en déclin, affirme-t-il. Car il s’agit bien d’une puissance en déclin, et non d’une puissance en ascension. Habermas condamne l’incapacité ou le désintérêt des dirigeants européens, leur incompréhensible myopie dans leur vision des États-Unis en tant que puissance dominante. La confiance inébranlable du chancelier allemand Scholz dans l’unité de l’Occident sous la présidence américaine de Biden en réponse à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a conduit les autres dirigeants européens dans la mauvaise direction au lieu de pousser l’Europe à prendre ses responsabilités en Ukraine pour défendre sa sécurité et les valeurs européennes. Cet échec s’est avéré désastreux lorsque Trump a commencé à négocier avec Poutine au-dessus de la tête de l’UE, qui a été contrainte de rester spectatrice, argue Habermas. Avec Trump 2, la question du sort de l’Ukraine est devenue une question de survie de l’UE dans une situation où elle ne peut compter sur la protection des États-Unis.
Scholz porte certainement une part de responsabilité dans l’obsession de l’Europe pour les États-Unis après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, peut-être plus que quiconque. Mais à sa décharge, on peut dire que les liens de l’Allemagne avec l’Occident étaient solidement enracinés depuis Adenauer et se sont encore renforcés après la fin brutale, en février 2022, des relations étroites avec la Russie sous la devise « Wandel durch Handel » (le changement par le commerce). Ces liens avaient été forgés par Willy Brandt au début des années 1970 dans une situation historique complètement différente, sous la devise « Wandel durch Annäherung » (le changement par le rapprochement). Lorsque cette devise a été reformulée dans une optique néolibérale après 1990, l’idée fatidique est apparue que le marché régissait automatiquement cet arrangement. En tant que ministre des Finances dans la grande coalition avec Angela Merkel, Scholz s’est éloigné des idées de Brandt, mais il était loin d’être le seul. En Allemagne, la confiance dans les États-Unis était aussi inébranlable qu’en Russie avant février 2022, après que les gens aient pu rejeter Trump 1 avec un soupir de soulagement comme une parenthèse. Enfin, les demandes d’adhésion à l’OTAN de la Finlande et de la Suède après l’attaque russe contre l’Ukraine montrent que l’Allemagne de Scholz n’était pas seule à faire confiance aux États-Unis.
Si Scholz est désormais le candidat le plus évident pour être qualifié de Chamberlain de notre époque, la question est de savoir qui est Churchill. Ici, seul le président ukrainien Zelensky peut être envisagé. Sans entrer dans le détail des similitudes, une différence décisive peut être identifiée. Churchill avait le soutien des États-Unis et, après l’été 1941, également celui de l’Union soviétique. Plus la guerre se prolonge, plus Zelensky semble seul. L’impuissance de l’Europe s’accroît à mesure que Trump et Poutine négocient sur l’Ukraine. L’Europe est confrontée à la tâche de reprendre le rôle des États-Unis dans le soutien à l’Ukraine, mais il semble qu’il n’y ait pas de place pour elle dans la dynamique qui se dessine. Les difficultés sont grandes, mais le refus de le reconnaître et d’en tirer les conséquences les rend encore plus grandes.
L’imprévisibilité est totale dans le contexte de ce que Habermas décrit comme le « comportement bizarre et le discours confus » de Trump lors de la cérémonie d’investiture en janvier 2025, avec « l’incantation fantastique d’un âge d’or qui s’annonce ». L’affectation narcissique de Trump a donné aux téléspectateurs non préparés qui ont regardé la cérémonie l’impression d’une « démonstration clinique d’un cas psychopathologique », mais les applaudissements tonitruants dans la salle et « l’accord expectatif de Musk et des autres sommités de la Silicon Valley » n’ont laissé aucun doute sur la détermination du cercle restreint de Trump. La feuille de route porte la signature de la Heritage Foundation et est connue depuis longtemps (Heritage Foundation 2024). Il s’agit d’une restructuration institutionnelle de l’État. Les exemples européens dans le même esprit, impliquant des personnalités telles qu’Orbán et le régime Kaczynski, se limitent à des restrictions étatiques sur le système juridique et les médias. La refonte aux États-Unis est beaucoup plus radicale. Le commissaire à la purge Musk, armé d’une tronçonneuse, a des objectifs plus ambitieux que la simple réduction de l’administration publique. L’objectif à long terme est de remplacer l’appareil étatique et ses réglementations par une technocratie contrôlée numériquement, affirme Habermas. La politique dans le cadre de l’État historique doit être remplacée par une gestion d’entreprise contrôlée numériquement par une administration publique fortement allégée (Habermas 2025). Les plans des techno-oligarques visant à transformer le gouvernement en un conseil d’administration d’entreprise auraient, s’ils étaient réalisés, des conséquences difficiles à prévoir.
Pour Habermas, il n’est pas tout à fait clair comment ces idées expansives peuvent être conciliées avec le style d’action de Trump, une « politique de décisions étonnamment arbitraires, libérée des normes en vigueur ». Le fantasme obscène de l’homme d’affaires et agent immobilier de reconstruire la bande de Gaza vide suggère l’irrationalité d’une personne délibérément imprévisible qui pourrait entrer en conflit avec les plans à long terme du vice-président, motivés par la religion, pour une définition populiste de droite ou autocratique de la démocratie, où la liberté numérique totale pour les géants de la technologie est le principe directeur. Habermas note que le type autoritaire de numérisation n’a pas grand-chose à voir avec le fascisme historique. Une fois détruites, les institutions ne peuvent pas être facilement recréées. À la conclusion de Habermas, on peut ajouter que les paladins, les flagorneurs et les bouffons qui composent l’entourage immédiat du président américain ne sont en rien nouveaux. L’histoire en fournit de nombreux exemples. Ce qui est nouveau, c’est leur pouvoir technologique, qui soulève des questions sur qui contrôle réellement.
L’imprévisibilité comme instrument politique du pouvoir ne signifie pas que Trump n’a pas de plan ni d’objectif. Il faut supposer qu’il est sérieux et qu’il a un plan pour rendre l’Amérique grande et forte à nouveau, même si l’on discute étonnamment peu de ce à quoi pourrait ressembler un tel plan. Il est difficile de discerner une réflexion à long terme dans une approche saccadée où les objectifs sont fixés et où l’appel à l’attaque est lancé aussi rapidement que l’appel à la retraite : paix en Ukraine, droits de douane pour protéger les États-Unis de l’exploitation étrangère, etc. Il appelle à l’attaque et promet de grandes choses et des avancées décisives, mais lorsqu’il se heurte à une forte résistance, l’attaque s’arrête et une nouvelle énergie est investie dans un nouvel objectif, et ainsi de suite. Le passage de la « médiation pour la paix » en Ukraine à la campagne tarifaire effrénée, puis le retour à l’Ukraine, suit un schéma bien défini.
Trump veut détruire les institutions, les règles et les modèles de coopération de l’ordre mondial existant. Il veut créer un (dés)ordre où les forts règnent en maîtres. Les petits États n’ont aucune importance. Une poignée de superpuissances décident entre elles du sort du monde. Leurs accords sont souvent non écrits, secrets et/ou implicites et ne sont pas nécessairement durables.
C’est un mythe que l’impérialisme a disparu avec la décolonisation après 1945. Pendant la guerre froide, il s’est poursuivi dans le tiers monde sous forme de guerres par procuration entre superpuissances et de concurrence avec des armes conventionnelles (Westad 2005; Stråth & Trüper 2025). Mais, étonnamment, il est devenu aussi fort qu’il l’est aujourd’hui.
Si vous regardez un globe terrestre vu d’en haut et que vous suivez la masse continentale canadienne depuis le détroit du Labrador vers l’ouest, vous arrivez en Alaska, puis vous traversez le détroit de Béring pour rejoindre la Sibérie et enfin Mourmansk. De là, il n’y a qu’un pas jusqu’au Groenland. En regardant dans l’autre direction, vers l’est depuis le Labrador, vous atteignez rapidement le Groenland, et de là, vous pouvez rejoindre Mourmansk de l’autre côté. Si le Groenland et le Canada appartenaient aux États-Unis, ceux-ci et la Russie embrasseraient le globe sous le pôle Nord et contrôleraient les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est. Ils contrôleraient également des quantités inconnues de minerais rares. Il convient de souligner qu’il s’agit là d’un raisonnement hypothétique et que, s’il s’avère vrai, ce que Trump veut est une chose et ce qu’il parvient à réaliser en est une autre. Mais il faut supposer que Trump a un plan et une vision du monde. La Russie de Poutine n’est pas près de tomber comme un fruit mûr devant les invitations de Trump et doit également tenir compte de ses relations avec la Chine. Les relations impérialistes entre les superpuissances ne sont pas nécessairement harmonieuses. Elles sont motivées par le pouvoir et opportunistes, changeantes plutôt que durables.
Dans le contexte de cette réflexion hypothétique mais pas irréaliste, il est frappant de constater à quel point l’Europe semble isolée et insignifiante dans le jeu de la paix en Ukraine et du rapprochement entre les États-Unis et la Russie. On ne peut que conclure que si la paix signifie que Poutine conserve ce que la Russie a conquis et que Trump oblige une Ukraine déchirée et épuisée par la guerre à accepter l’extraction américaine des minerais dans ce qui reste de l’Ukraine, alors oui, les fouilles et les forages américains garantiront l’intégrité du reste de l’Ukraine contre l’agression russe. À quel prix, pourrait-on se demander, mais aucune force européenne de maintien de la paix ne sera nécessaire.
Dans un court article, Nils Gilman voit émerger une coalition pétrolière et gazière contre les énergies renouvelables entre les États-Unis et la Russie sur la base de la pollution atmosphérique continue (Gilman 2025). Dans ce contexte, il convient de noter l’intérêt déclaré de la Russie et des États-Unis pour le Moyen-Orient. Une telle coalition contrôlant l’Arctique avec les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est pourrait difficilement éviter un affrontement avec la Chine, qui plus que toute autre puissance s’est profilée comme le champion de l’énergie verte. Les États-Unis et la Russie ne peuvent pas exclure la Chine, et ne le font pas, mais cherchent un arrangement avec ce qui était autrefois appelé l’Empire du Milieu et semble aujourd’hui vouloir retrouver ce nom. Un futur triangle dramatique pourrait émerger à la place d’un triumvirat. Quelle est la position de l’UE dans une telle situation ? Et celle de l’Inde ? L’idée, s’il y en a une, est-elle d’apaiser Trump, ou l’UE doit-elle espérer que tout s’arrangera ? Comme la souris qui regarde le serpent avec effroi, essayant euphémiquement de cacher sa paralysie en prétendant avoir du sang-froid.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Deux interprétations américaines
Une multitude d’ouvrages tentent de comprendre et d’interpréter les développements aux États-Unis. Deux livres seront mis en avant ici, sans prétendre à l’exhaustivité, pour illustrer les interprétations possibles.
Robert Kagan, qui comparait les États-Unis à Mars et l’Europe à Vénus (Kagan 2003), a abandonné ses convictions néoconservatrices de l’époque de la guerre en Irak et réfléchit dans un nouveau livre à la manière dont les événements américains auraient pu se dérouler autrement (Kagan 2024). Son point de départ est que la Constitution américaine de 1787 était viciée dès le départ. Elle proclamait l’égalité et les droits de tous les citoyens, mais ses auteurs étaient conscients que les esclaves noirs n’étaient pas inclus. Washington et Jefferson possédaient tous deux des esclaves. Les Pères fondateurs se consolaient en espérant qu’à un moment donné de l’évolution du peuple américain, la raison l’emporterait et qu’un accord serait trouvé sur l’abolition de l’esclavage. Dans les années 1830, des tensions sont apparues lorsque de nouveaux États ont dû être admis dans l’Union et que leur statut sur la question de l’esclavage a dû être déterminé. Ces tensions ont déclenché la guerre civile de 1861-1865. Le conflit ne portait pas seulement sur l’esclavage, mais aussi sur les divisions entre les villes et les campagnes et les différents niveaux d’industrialisation, les forces illibérales remettant continuellement en cause la constitution libérale.
Après la guerre civile, l’immigration et l’industrialisation se sont intensifiées et de nouvelles tensions sont apparues entre les nouveaux groupes ethniques : Anglo-Saxons/Européens du Nord contre Européens du Sud contre Européens de l’Est contre Chinois contre Japonais. La loi d’exclusion des Chinois de 1882 et la loi sur l’immigration de 1924 ont exprimé ces tensions. Le melting-pot était tout sauf harmonieux. Le débat sur la race s’est intensifié. Les années 1920 ont été l’époque du jazz, mais aussi du Ku Klux Klan, et les tendances illibérales étaient évidentes pendant la crise des années 1930. Les courants universalistes, cosmopolites, internationalistes, progressistes et libéraux éclairés ont toujours été présents, mais ils ont été constamment remis en question, même si les années 1930 à 1950 ont été fondamentalement libérales. Mais il y avait aussi le Ku Klux Klan, McCarthy et la question raciale avec les busing, Little Rock et Martin Luther King. Et John F. Kennedy, qui a envoyé la Garde nationale pour mettre fin à la discrimination raciale dans les universités. C’était comme si la société américaine n’avait jamais trouvé sa stabilité, mais était constamment remise en question. Le 11 septembre s’inscrit bien dans ce schéma d’agitation. Comme mentionné, Huntington avait déjà écrit en 1996 (Huntington 1996) sur la confrontation entre les civilisations comme défi de l’avenir. Cela concernait principalement les civilisations chrétienne et musulmane, qui allaient s’affronter en 2001 sous la forme du fanatisme religieux, du terrorisme et de la guerre. Mais Huntington s’inquiétait également de la composition de la population américaine. En 1965, les Blancs d’origine européenne représentaient 84 % de la population américaine. Les Hispaniques représentaient moins de 4 % et les Asiatiques moins de 1 %. Au début des années 2000, la proportion de Blancs d’origine européenne était tombée à 62 %, avec une tendance à la baisse, tandis que les Hispaniques représentaient 18 % et les Asiatiques 6 %, avec une tendance à la hausse. Huntington (2004) s’est inquiété de la culture anglo-protestante qui a trouvé son expression politique dans la Constitution de 1787.
Il est important de rappeler que le mouvement libéral des Lumières a toujours été présent. George W. Bush était un véritable multiculturaliste et cosmopolite. Mais il a été constamment contesté par des fondamentalistes antilibéraux, des fanatiques religieux et des guerriers culturels. À bien des égards, le conflit de répartition sociale a été éclipsé par le débat culturel, et cette occultation est devenue un problème que Trump a su exploiter avec succès. Selon Kagan, la longue tradition antilibérale s’exprime dans le mouvement de Trump. Kagan considère Trump comme s’inscrivant dans une longue lignée de continuité antilibérale américaine. Kagan n’hésite pas à comparer directement Trump à Hitler en tant que leader charismatique, jouant sur les émotions et incitant à la peur, à la terreur et à l’anxiété. Trump crée l’obéissance par la peur plutôt que la loyauté par la confiance. La question que Kagan n’explore pas en profondeur est de savoir si nous pouvons continuer à compter sur un retour de la continuité libérale tout aussi longue depuis la fondation du pays, les deux continuités s’affrontant constamment.
Les politologues Stephen Hanson et Jeffrey Kopstein ont une perspective internationale plus large sur les développements américains. Ils voient se dessiner une tendance qui s’est manifestée au cours des dernières décennies, qu’ils relient à ce que Max Weber appelait le paternalisme, une sous-catégorie de la régime de pouvoir traditionnelle dans sa typologie des régimes de pouvoir (Hansson & Kopstein 2024, Weber 1980 [1922] : 122-176). Il s’agit d’un régime arbitraire dirigé par des leaders qui se présentent comme les pères de la nation, promettant grandeur et sécurité à une époque perçue comme incertaine et en déclin. Ils s’entourent d’une cour composée de membres de leur famille, de favoris et d’experts en haine au sein des administrations gouvernementales et des organisations internationales. Les dirigeants et leurs proches n’hésitent pas à s’enrichir aux dépens du public. La corruption est un élément important du système, un lubrifiant. Les exemples historiques cités par Hanson et Kopstein sont les tsars russes. Lorsque cela était nécessaire, ils recouraient à des mesures coercitives et mobilisaient le soutien des élites économiques et intellectuelles. Leur point commun est qu’ils violent l’État de droit et les principes juridiques et introduisent l’arbitraire dans le système. Des concepts tels que l’autocratie, la dictature, l’autoritarisme et le populisme rendent compte du phénomène, mais ne couvrent pas toute sa complexité. En Europe, les pensées se tournent vers Poutine et Orbán, et aux États-Unis, bien sûr, vers Trump. Mais il existe de nombreux autres noms, tels que Johnson, Bolsonaro, Erdogan, Milei et Modi, tous différents les uns des autres et ayant leur propre profil. Le phénomène est mondial. Trump n’est donc pas unique, mais suit un modèle émergent, même s’il semble être le plus ostentatoire et celui qui recherche le plus les feux de la rampe dans son entourage.
Cette évolution constitue une attaque mondiale à grande échelle contre l’État moderne fondé sur des règles, le déclin de la démocratie et la transition vers un régime personnel. Hansson et Kopsstein considèrent Poutine comme le maillon peut-être le plus important de cette transformation et n’hésitent pas à le désigner comme la source d’inspiration de Trump. Dans le même temps, ils soulignent que le succès de Poutine en tant que figure de proue est dû au fait que le terrain avait été bien préparé. L’idéologie néolibérale a transformé de nombreux libéraux sociaux en libertariens. Elle décrivait l’appareil d’État comme un carcan étouffant, qui devait se tenir à l’écart de l’économie, sauf pour garantir la liberté du marché. Le message était puissant et a porté ses fruits. Hansson et Kopstein désignent l’effondrement des marchés financiers en 2008 comme le déclencheur de cette évolution paternaliste, mais dans le cas de la Russie, il y a eu un prélude : les hordes de consultants occidentaux qui ont afflué dans l’empire soviétique en décomposition et ont dit aux administrateurs judiciaires ce qu’ils devaient faire. La propriété d’État fossilisée devait être privatisée, ce qui permettrait de revitaliser l’ensemble de l’économie. La démocratie prendrait du temps, mais elle suivrait automatiquement une économie en plein essor. La vente interne des biens en faillite, initiée et encouragée par l’Occident, a alimenté l’amertume de Poutine, qui voyait de plus en plus l’effondrement de l’empire soviétique comme une catastrophe historique. En fin de compte, son objectif est devenu de chercher à le recréer. Ce n’est pas l’OTAN en tant que menace extérieure, mais la désintégration interne de ce qui avait été promis comme un paysage florissant qui a poussé Poutine à agir et à abandonner la fragile démocratie qui cherchait à remplacer la dictature. Les années 2006-2008 ont vu un changement de cap, avec les ambitions occidentales de la Géorgie – où Poutine voyait naturellement l’OTAN comme une menace – et le discours de Munich comme des étapes importantes, et l’effondrement des marchés financiers en 2008 comme la confirmation de la décadence et de la pourriture de l’Occident capitaliste et du bien-fondé du revirement.
Le sombre décor, l’acteur et les producteurs du drame
In Cue the Sun! – The Invention of Reality TV, Emily Nussbaum (2024) décrit comment l’acteur Donald Trump s’est incarné dans une série télévisée en tant que version plus riche et plus prospère d’un agent immobilier en difficulté que les banques commençaient à soupçonner. Il s’est mis en scène comme le magnat richissime que des millions d’Américains qui suivaient la série ont ensuite pris pour ce qu’il était. Il jouait une version caricaturale de lui-même, et le public prenait cette caricature pour la réalité. L’acteur lui-même prenait également cette caricature pour son vrai moi. Cela a si bien fonctionné, écrit Nussbaum, parce que Trump maîtrisait particulièrement bien un trait de caractère : l’art de créer des rebondissements inattendus. À cet égard, Trump se comportait souvent de manière si impulsive et s’écartait tellement du script qu’il poussait les éditeurs responsables au désespoir. Ils devaient rééditer des épisodes ou même fournir des dialogues entiers avec une voix off modifiée après coup. Mais quelle que soit la frustration des producteurs, ils ont également remarqué que les impulsions erratiques de Trump, ses rebondissements soudains et ses caprices surprenants maintenaient le public en haleine sous la devise : « Il se passe toujours quelque chose dans le monde de Trump ». C’est ainsi qu’il faut également imaginer le vrai président Trump lorsqu’il joue le président Trump.
En réalité, ses scénaristes et ses éditeurs sont également en coulisses, prêts à corriger à tout moment les écarts par rapport au script. Ce serait une grave erreur d’ignorer son cercle de conseillers et ceux qui écrivent le script et produisent le drame. Trump n’est certes pas une marionnette, mais il n’a pas écrit le scénario lui-même.
Parmi les producteurs figure le vice-président, le très pieux J. D. Vance, qui s’est converti au catholicisme en 2019 et semble plus confiant et indépendant que tous ses prédécesseurs. Et plus idéologique. Le catholicisme qui l’anime n’est pas celui du courant dominant, mais celui d’un mouvement ultra-conservateur qui respire la contre-révolution dans l’esprit de Maistre, le penseur anti-Lumières qui a annoncé le romantisme. Pour Vance, la politique n’est pas tant une compétition pour la majorité qu’une lutte existentielle entre le bien et le mal.
Dans ses mémoires, Hillbilly Elegy (2016), J.D. Vance raconte son enfance auprès d’une mère toxicomane dans les mines de charbon des Appalaches, où il se sentait inférieur parce que l’establishment américain les méprisait. Ces sentiments ont fait naître en lui un besoin d’affirmation de soi. Dans son récit, il écrit qu’il n’est pas devenu radical, mais que c’est la gauche qui s’est radicalisée. Elle avait transformé les universités en monoculture intellectuelle. Elle avait transformé les États-Unis en une façade démocratique dirigée par une bureaucratie experte, le « deep state », comme Vance appelle le régime, que l’idéologue du mouvement Curtis Yarvin appelle la « cathédrale » et Peter Thiel, le philosophe parmi les milliardaires de la tech, appelle le « ministère de la vérité ». Ils réclamaient tous une révolution par le haut sous le slogan RAGE, Retire All Government Employees (Retraite de tous les fonctionnaires). Yarvin, né en 1973, blogueur et développeur de logiciels, était déjà au début des années 2000, avec Nick Lane, peut-être la figure la plus éminente d’une communauté antidémocratique et anti-égalitaire, plutôt que d’un mouvement, une communauté numérique avec des slogans tels que « alternative right », « alt right », « néo-réactionnaire » et « dark enlightenment » (Lane 2022, Yarvin 2024). Dans leurs apparitions médiatiques, ils se présentaient comme tournés vers l’avenir, mais ils tiraient leurs visions du futur d’une manière particulière du passé. Curtis Yarvin s’inspirait de Thomas Carlyle, un idéaliste social du XIXe siècle qui considérait l’histoire comme la création de héros. Ils prônaient un retour à la monarchie sous de nouvelles formes, où une entreprise remplacerait l’État sous une gestion monarchique responsable. Leur ennemi principal était tout ce qui avait trait à la démocratie, aux idées libérales, aux Lumières et à l’idée de progrès. Ce qui est soudainement devenu une réalité politique avec Trump 2, choquant et surprenant tout le monde, s’est développé au cours d’un long processus de fermentation sous la surface de la démocratie que le débat public occidental considérait comme acquise. Sous Trump 1, cette fermentation a quelque peu bouillonné, mais elle a disparu sous Biden. Lorsque les porte-parole du nouvel ordre parlaient de politique néo-réactionnaire, ils ne faisaient pas référence au conservatisme de leurs grands-pères ou d’Edmund Burke, mais à l’association des principes de l’ingénierie moderne et des idées antidémocratiques classiques à l’ère de l’internet 2.0. Les Lumières et l’idée de progrès qui en a découlé étaient une erreur. Le libéralisme démocratique fondé sur les idéaux de liberté et d’égalité doit être considéré à travers le prisme darwinien.
Vance s’inscrit dans cette ligne lorsqu’il collabore avec Steve Bannon, conseiller de Trump pendant son premier mandat, pour construire un mouvement nationaliste international de droite. Ils veulent transformer les populistes et les extrémistes de droite européens en un instrument du MAGA, un instrument subversif doté d’un programme antilibéral, autoritaire et paternaliste visant à redéfinir le pouvoir populaire et à détruire la démocratie libérale et sa plus grande réalisation : l’État-providence. Poutine n’exprime pas son objectif différemment, d’autant plus que Trump a ajouté l’expansion impérialiste à son programme. Deux programmes politiques qui se recoupent émergent, l’un américain, l’autre russe. D’une part, ils cherchent le conflit avec l’Europe afin de les mettre en œuvre. D’autre part, ils recherchent des partenaires en Europe qui partagent le même objectif.
La force motrice et l’objectif de Donald Trump sont de rendre à l’Amérique sa grandeur. Il entend y parvenir en revitalisant la Rust Belt. L’accent est mis sur l’industrie manufacturière, en particulier l’industrie automobile. Les droits de douane, dont le montant semble avoir été fixé au hasard, visent à exclure les concurrents et/ou à les contraindre à implanter des usines aux États-Unis. Derrière cet objectif se cache une pensée mercantiliste et statique. Il y a là une contradiction. Les usines qui fabriquent des voitures et d’autres produits ne créent pas seulement des emplois, mais dans le monde globalisé d’aujourd’hui, elles importent également des composants dont les coûts montent en flèche en raison des droits de douane. Et ces coûts se répercutent sur les prix. Ce n’est pas un hasard si l’industrie automobile américaine a commencé à licencier du personnel lorsque Trump a augmenté les droits de douane. La grandeur à laquelle Trump aspire appartient au passé. Si l’idée sous-jacente est de détruire l’ordre mondial existant et le système politique américain, alors les contradictions entre Trump et les oligarques sont évidentes. Cependant, cela ne pose pas de problème, bien au contraire. Les contradictions et les conflits internes contribuent à la confusion générale et créent le chaos. Les auteurs du drame Trump se frottent les mains de joie.
La destruction de la démocratie européenne est un objectif important de la campagne des tech-oligarques pour un nouvel ordre mondial. Le vice-président Vance, protégé de Peter Thiel, est le plus éloquent et le lien entre les tech-oligarques et Trump. Sa déclaration lors de la conférence sur la sécurité à Munich en février 2025 n’était pas une coïncidence. Lorsque les services secrets allemands ont remis au gouvernement fédéral, en mai 2025, un rapport de 1 100 pages concluant que le parti populiste de droite Alternative pour l’Allemagne était anticonstitutionnel et extrémiste, Vance s’est exprimé de manière aussi grandiloquente qu’à Munich, affirmant que le mur que les États-Unis et l’Allemagne de l’Ouest avaient abattu en 1989 était en train d’être reconstruit par le seul gouvernement allemand. Marco Rubio a ajouté que l’Allemagne était une tyrannie. Le vice-président et le secrétaire d’État ont ignoré le fait qu’il s’agissait d’un rapport officiel qui n’avait pas été traité politiquement lorsqu’ils ont déclaré, comme Vance à Munich, qu’une Allemagne démocratique devait intégrer pleinement l’AfD dans le débat parlementaire. Tout autre choix serait antidémocratique. Vance promeut le mythe d’une véritable majorité démocratique qui inclut les extrémistes de droite, et celui d’une fausse majorité créée dans le centre, en prenant l’Allemagne comme exemple.
La redéfinition du concept de démocratie par le vice-président va dans le sens du mouvement völkisch des années 1930. Les populistes de droite, aujourd’hui extrémistes de droite en Allemagne, tendent dans la même direction, où le populisme et le Volksgemeinschaft, le communauté du peuple, sont réunis dans les mythes du passé. Cette vision est aussi dangereuse aujourd’hui qu’elle l’était dans l’Allemagne des années 1930. Vance poursuit la campagne de Steve Bannon sous Trump 1 en faveur d’une internationale autoritaire et paternaliste de nationalistes de droite et d’antilibéraux, avec le soutien influent d’Elon Musk et du secrétaire d’État Rubio. L’objectif est de coopérer au sein de cette internationale avec les nationalistes de droite européens, regroupés au Parlement européen. Ils défendent ce que le régime Trump définit comme l’avenir démocratique de l’Europe. Ils garantiront aux plateformes technologiques une liberté totale en matière de réglementation en Europe. Leur grand espoir en Europe est Georgia Meloni, qui semble essayer de maintenir un équilibre entre le concept de démocratie de l’UE et le mépris des entreprises technologiques pour la démocratie.
Les politiques de Trump contrastent fortement avec le programme des oligarques technologiques sur des questions cruciales. Leur avenir ne réside pas dans la Rust Belt et les champs pétrolifères. Ils rêvent de coloniser Mars, de voyager dans l’espace et d’atteindre la vie éternelle grâce à l’intelligence artificielle (Peter Thiel). Ils ne disent rien sur l’emploi, mais réfléchissent à la manière dont l’IA pourrait remplacer les emplois. Ils affichent clairement leur mépris pour l’État profond et son expertise. Ils veulent le détruire et le remplacer par une entreprise entièrement numérisée, dirigée par les oligarques technologiques. La surveillance par le recours massif à l’IA fera probablement partie de l’arsenal du gouvernement. Trump semble adhérer pleinement au programme des oligarques technologiques et le manifeste en engageant Elon Musk pour le travail de destruction. Mais on ne sait pas s’il comprend les implications et la portée du programme, ni son propre rôle dans celui-ci. Son expérience se limite à celle d’un spéculateur immobilier et d’un acteur de télévision. Le limogeage de Musk en tant que destructeur en chef de l’État après moins de six mois montre également qu’il existe des tensions entre les oligarques et entre ceux-ci et Trump. En tant que constructeur automobile, Musk s’opposait à la politique tarifaire.
Trump et les oligarques technologiques sont unis dans leurs efforts pour transformer les États-Unis en un nouveau paradis fiscal mondial et introduire des zones de non-droit dans le monde offshore, comme le décrit Slobodian dans Crack-Up Capitalism (2023). L’administration Trump encourage le commerce des cryptomonnaies et soutient les casinos en ligne et les plateformes de paris. Avec son projet de réserve stratégique en cryptomonnaies, Trump sape le dollar sans le vouloir. La force motrice des cryptomonnaies est le désir de dissimuler de l’argent dans le blanchiment et l’évasion fiscale. Tout cela dans le but de renforcer l’économie illégale mondiale. Les États-Unis se retirent des négociations internationales sur la coopération fiscale et de nombreuses autres coopérations internationales. Joseph Stiglitz (2025) voit une seule lueur d’espoir : le départ des États-Unis permettra au reste du monde de poursuivre plus facilement ses travaux sur la fiscalité internationale des entreprises multinationales dans le cadre du G20, de l’ONU et de l’OCDE, sans les États-Unis, qui ont jusqu’à présent été le principal obstacle à tout progrès.
Parallèlement à l’œuvre d’une société anarchique, numérisée et à faible fiscalité, où règnent le chaos et la loi de la jungle sans intervention gouvernementale, Trump tente de créer de l’ordre en recréant la société industrielle dont l’apogée appartient au passé. Cependant, la croissance ne provient plus de cette dernière, mais de la production de services, en particulier financiers. Trump veut tout laisser sans réglementation, libre à l’enrichissement personnel sans aucune prétention à l’autorité. Cet ordre s’applique aux travailleurs de la Rust Belt qui réclament à grands cris la sécurité et la reconnaissance morale et économique. Ce sont eux qui soutiennent le populisme comme source de mécontentement. Pour eux, il veut ramener la production industrielle aux États-Unis.
Depuis 2008, deux mots clés sont à l’ordre du jour : social et nation. C’est la démocratie libérale qui a réussi, après 1945, à les réunir dans l’État providence. Dans la lutte pour une redéfinition qui est désormais engagée, les contestataires invoquent un modèle historiquement éprouvé et beaucoup plus radical, celui du national-socialisme. L’expérience s’est soldée par une catastrophe gigantesque. C’est sur les ruines de cette catastrophe que les États-nations démocratiques ont été construits. Toutes les forces doivent être mobilisées pour empêcher qu’ils ne deviennent de nouvelles ruines. Chacun doit prendre conscience que des forces puissantes œuvrent pour que cela se produise. Il ne s’agit pas seulement de quelques spin doctors et de quelques showmen. Il s’agit des forces obscures et profondes de destruction qui cherchent l’apocalypse avant la transcendance vers le monde de l’IA, avec le romantisme de la contre-révolution comme idéologie et la technologie numérique de pointe comme arme. Il ne s’agit pas, comme le prétendent les hommes de l’ombre, de l’État profond et de ses experts. Ceux-ci ne sont qu’un obstacle sur le chemin.
Derrière les idéologues et leur porte-parole politique, le vice-président Vance, se cachent les oligarques de la technologie. Les qualifier de riches est un euphémisme. Les penseurs de premier plan sont les éminences grises, le capital-risqueur Marc Andreessen et l’énigmatique Peter Thiel, également capital-risqueur et philosophe de formation (Chafkin 2022, Thiel 2014). La philosophie de Thiel a une dimension théologique développée en réflexion avec l’anthropologue de religion René Girard, qui fut son mentor dans les questions profondes de la croix et de la résurrection, de la révélation, de l’apocalypse et de la transcendance. Le mot à la mode est « disruption ». Détruire et transcender les frontières. La transcendance, c’est l’IA qui remplace les humains et, dans sa perfection, atteint la vie éternelle. Thiel ne croit pas à la concurrence libérale, mais plutôt au monopole illibéral. Il n’a aucun problème avec le pouvoir étatique centralisé et la violence policière. Agir vite et casser les codes, comme le dit Mark Zuckerberg. On sent derrière cette nouvelle certitude de foi le philosophe de la volonté et de la surhumanité, Friedrich Nietzsche. Ce même Nietzsche qui, dans sa vision cyclique du temps, avertissait également que l’humanité répéterait sans cesse ses erreurs sans en tirer les leçons : « O Mensch, Gib acht » (Nietzsche 1891), que Gustav Mahler a mis en musique de manière si poignante dans sa Troisième Symphonie. On peut lire Nietzsche de manière sélective dans le but de nier son ambivalence entre le cyclique et le transcendant. Le potentiel de chute existe dans les deux versions, triomphante et mise en garde. Le surhumain de Nietzsche émerge clairement lorsque Peter Thiel voit dans l’IA l’instrument qui permet la vie éternelle. Mais les oligarques technologiques, avec leur immense potentiel de pouvoir, ne sont pas seulement des rêves philosophiques visant à rendre l’impossible possible, mais aussi Elon Musk avec sa tronçonneuse, et les plus terre-à-terre Zuckerberg, Bezos et bien d’autres. Les rejeter comme étant sans rapport avec Trump serait une grave erreur. Ce sont eux qui écrivent le scénario et produisent le drame de Trump.
Le slogan « Make America Great Again » ne doit pas être considéré comme une idéologie cohérente, mais plutôt comme un discours plein de contradictions, où certains veulent une position plus dure envers la Chine, tandis que d’autres souhaitent une approche plus souple. L’Europe n’est pas particulièrement pertinente, si ce n’est en tant qu’Europe populiste et extrémiste de droite sous la puissance numérique américaine.
Et maintenant, Europe ?
La situation géopolitique a fondamentalement changé. Ou pour mieux dire : l’ordre en désintégration que l’on appelait l’Occident s’est transformé en géopolitique mondiale. Pour l’Europe, le front de la guerre froide est de retour, à cette différence cruciale près que l’Europe n’a plus les États-Unis derrière elle et que l’Europe occidentale est devenue une Europe avec des responsabilités accrues en matière de politique de sécurité, mais aussi avec des tensions internes plus vives. La politique impériale russe va plus loin que pendant la guerre froide, où l’équilibre de la terreur nucléaire imposait une certaine retenue. Il s’agit désormais d’une guerre conventionnelle avec la menace des armes nucléaires en toile de fond. On craint que les États baltes, la Géorgie et la Moldavie ne deviennent de nouveaux pions dans les ambitions de Poutine visant à restaurer les frontières de l’empire soviétique. Au-delà de l’Ukraine, bien sûr.
C’est cette situation qui a conduit Habermas à se mettre à penser en termes géopolitiques, un domaine inexploré pour lui, ce qui montre à quel point le changement est radical. Il affirme que l’Europe doit approfondir sa coopération pour répondre à la situation et accuse Olaf Scholz de négligence à cet égard en tant que chancelier. Habermas ne conteste pas les arguments en faveur du réarmement militaire, mais met en garde, dans le contexte de la montée en puissance de l’AfD, contre une militarisation de l’Allemagne, et c’est sur ce point qu’il fait intervenir l’Europe. Dans un article faisant suite au manifeste de Habermas, l’historien Norbert Frei, de l’université d’Iéna, clarifie les arguments généraux de Habermas en faveur d’une coopération européenne renforcée en matière de défense. Dans un contexte de montée du populisme de droite, qui provoque des troubles dans le monde entier, cela doit passer par une communauté européenne de défense, telle qu’elle était envisagée en 1952-1954, afin de pouvoir utiliser et en même temps contrôler la puissance militaire de l’Allemagne de l’Ouest. L’européanisation de la défense serait une réponse aux préoccupations européennes concernant le réarmement allemand (Frei 2025).
Il s’agit donc de transposer l’Union du charbon et de l’acier de Robert Schuman dans le domaine militaire. Pour les dirigeants européens et l’opinion publique, il s’agit de comprendre et de s’identifier à l’énormité de la tâche de Robert Schuman en 1950 : convaincre l’Europe de la nécessité de réarmer l’Allemagne cinq ans après la guerre mondiale et réaliser le courage intellectuel que cette tâche exigeait. Et de réaliser que cette tâche est tout aussi incroyable aujourd’hui. Mais, comme Schuman, être convaincu que l’incroyable est possible, mais qu’il faut agir.
La crise transatlantique est fondamentalement une crise de confiance déclenchée par le manque de clarté du président américain quant à son engagement envers l’OTAN et ses intentions à l’égard de la Russie. La confiance perdue face aux menaces extérieures ne peut être facilement rétablie. Les dommages sont durables dans un avenir prévisible. La situation exige une action européenne indépendante grâce à une coopération renforcée. Cela ne signifie pas que l’Europe doit se rebeller contre les États-Unis ou quitter l’OTAN, mais plutôt qu’elle doit penser au-delà des États-Unis dans sa planification et sa préparation. Il s’agit en grande partie d’un processus mental qui nécessite un nouveau langage. L’objectif de la rupture doit être aussi proche que possible d’un divorce à l’amiable et aussi discret que possible, afin de laisser Poutine dans une certaine incertitude quant à ce qui se passe. Mais elle doit être claire et délibérée.
La rupture doit être fondée sur la conviction d’une Europe souveraine, capable d’agir avec confiance, en s’appuyant sur ses propres forces. L’image contraire qu’il faut dissiper est celle d’une photo qui a fait le tour du monde, montrant les quatre mousquetaires Macron, Starmer, Merz et Tusk à Kiev, assurant Zelensky de leur soutien total alors qu’ils appellent Trump sur un téléphone portable posé sur la table et le persuadent de promettre son soutien total à leur demande de cessez-le-feu. La promesse a été rompue le lendemain, et les quatre hommes ont été discrédités. Les mousquetaires étaient des acteurs impuissants qui contribuent au mépris des politiciens. La tâche qui nous attend exige un courage intellectuel et moral, qui doit se traduire par des plans concrets pour la souveraineté numérique avec des alternatives au GPS, aux services cloud actuels, à la réglementation de l’internet, et bien plus encore. Dans le même temps, l’indépendance politique doit être combinée autant que possible avec un soutien plus profond à la coopération transatlantique au sein de la société civile, avec les organisations bénévoles et au sein de la communauté scientifique afin de répondre aux attaques de l’administration Trump contre les universités et les liens familiaux et amicaux. L’Europe doit, en tant que société civile, soutenir les forces démocratiques aux États-Unis.
La référence de Frei aux plans de défense européens des années 1950 n’implique pas nécessairement une répétition des longues et détaillées négociations de l’époque et des délibérations sur la renonciation à la souveraineté nationale. Le temps manque pour cela, tout comme la volonté européenne. Il s’agit plutôt d’une coalition de volontaires pour approfondir la coopération en matière de défense. La coalition des volontaires était, après tout, l’expression utilisée par l’administration Bush pour désigner les États européens qui se sont joints à la guerre en Irak. Il s’agit maintenant de redéfinir sa signification dans le cadre d’un débat sur une nouvelle politique. L’Allemagne, la France, la Pologne, le Royaume-Uni et les pays nordiques et baltes pourraient former un noyau dans cet approfondissement, où davantage de mesures sont envisageables et où l’approfondissement en dehors du noyau n’a pas besoin d’être aussi important.
Limiter les problèmes liés à l’avenir de l’Europe au domaine militaire serait une grave erreur. Dans le désordre international qui se développe à la suite de l’effondrement des règles, qui fait partie de la politique de Trump et des oligarques technologiques sous le slogan de la disruption, il est de plus en plus nécessaire que l’Europe soit capable d’assumer ses responsabilités envers elle-même et le monde qui l’entoure d’une manière nouvelle. La situation de crise doit être mise à profit pour rétablir les règles et l’ordre et permettre une politique mondiale coordonnée contre le changement climatique, une alternative à la guerre qui détruit l’environnement et le climat. L’Europe doit trouver des liens avec la Chine, première puissance mondiale dans le domaine des technologies climatiques et partisane d’un ordre international fondé sur des règles. En tout état de cause, la Chine n’est pas favorable à une destruction systématique des règles. Les divergences de vues sur la démocratie sont importantes, mais elles ne peuvent constituer un obstacle à une coopération plus approfondie sur le climat et les règles internationales à court terme. L’Europe est entraînée dans une course aux armements difficile à éviter, mais il est important de trouver des alternatives avec une orientation différente de celle qui se dessine actuellement dans la politique mondiale, ce qui est peut-être aussi dans l’intérêt de la Chine. Et en tout état de cause, c’est dans l’intérêt de la planète. Il serait fatal de se laisser entraîner dans la spirale descendante des États-Unis dont Habermas met en garde.
Dans un discours puissant prononcé à Bruxelles le 8 mai 2025, Étienne Balibar a abordé la question « Et maintenant, l’Europe ? ». Balibar et Habermas forment le tandem philosophique franco-allemand asynchrone du continent, l’un plus néo/post-marxiste et écologiste, l’autre plus libéral et éclairé, dans leur plaidoyer incessant pour une Europe différente. La date du discours était symbolique, le 80e anniversaire de la capitulation à Reims et la veille du 75e anniversaire du discours européen de Robert Schuman. Balibar (2025) a déploré la vague de populisme de droite qui balaye l’Europe depuis une décennie. Beaucoup de ceux qui composent cette vague sont ouvertement nostalgiques du fascisme et du nazisme qui ont hanté le continent dans les années 1920 et 1930, comme s’il était temps d’oublier après deux ou trois générations. Ils disposent d’un pouvoir parlementaire et discursif important. Dans le cadre de la coopération européenne, ils représentent un potentiel dangereux. Xénophobes et animés par des projets nationalistes/impérialistes mesquins pour l’avenir, ils sont à la fois rivaux et apparentés. Compte tenu de l’époque dont ils s’inspirent, les tentatives visant à les « civiliser » ou à les « apprivoiser » sont vaines. Les partis populistes invoquent tous la grandeur nationale et rejettent l’idée d’une souveraineté définie au niveau européen. Ils veulent plutôt un modèle européen d’alliances géopolitiques et de conflits entre États-nations, avec la xénophobie comme moteur important.
En Europe, la guerre en Ukraine est en train de façonner une nouvelle division, un Yalta 2. L’Europe doit composer avec une Russie expansionniste fondée sur l’idéologie de Poutine d’une Grande Russie. Bien que Poutine, contrairement à Napoléon et Hitler, n’ait pas la capacité d’occuper toute l’Europe, ses plans englobent autant que possible l’ancien empire soviétique, y compris non seulement l’Ukraine, mais aussi les États baltes. En outre, l’Europe doit compter avec le fait que les États-Unis acceptent les ambitions de la Russie en échange de l’acceptation par cette dernière de celles des États-Unis dans l’Arctique. Bien qu’idéologiquement complètement différentes, une coopération russo-américaine est à prévoir. En peu de temps, les États-Unis sont passés du statut de centre mondial du néolibéralisme à celui de puissance nationaliste/impérialiste et néo-mercantiliste. Les relations entre les empires russe et américain posent à l’Europe un défi totalement différent de la concurrence capitaliste entre les États-Unis et la Chine, tous deux caractérisés par un fort étatisme. Cela soulève la question de l’avenir de l’étatisme américain, mais cette question ne modifie pas le tableau d’ensemble brossé par Balibar.
Balibar reconnaît toutefois que sa description de la situation présente une faille majeure. Elle ne tient pas compte de la numérisation et du développement de l’IA. Les algorithmes modifient fondamentalement le discours public. Ils colonisent les relations sociales. La description de la situation néglige également le changement climatique et les catastrophes environnementales, ainsi que la question connexe de l’organisation de la croissance économique dans le Nord et dans le Sud, note Balibar.
Après avoir brièvement écarté Timothy Garton Ash, qui a plaidé en faveur d’un empire européen en réponse à Trump et Poutine, Balibar se tourne ensuite de manière surprenante vers Alan Milward, qui a lancé la thèse très discutée à l’époque de Maastricht selon laquelle l’intégration européenne n’était pas une question d’un super état européen, mais de sauvetage de l’État-nation, The European Rescue of the Nation-State (Milward 1992). Dans le livre de Milward, Balibar trouve « la possibilité improbable d’une Europe fédérale ». Dans cette Europe qui a sauvé l’État-nation, sans laquelle l’État-nation n’aurait pas survécu. Contrairement à l’interprétation contemporaine du débat sur la distinction entre l’Europe et les États-nations, où le sauvetage des États-nations était la question principale, Balibar met l’accent sur l’Europe en tant que sauveur, donnant ainsi une nouvelle impulsion au débat sur le sujet. Balibar fait de l’Europe le sujet agissant. Dans le débat sur la thèse de Milward, les États-nations étaient les sujets agissants, tandis que l’Europe s’effaçait à l’arrière-plan après les avoir sauvés. Quant à la définition de la fédération, Balibar ne voit pas de différence fondamentale entre un État fédéral et une confédération. Les deux catégories se recoupent, et leur combinaison exacte relève davantage d’une perspective historique que d’une programmation téléologique, davantage de l’empirisme que de la théorie.
Balibar souligne que le principal problème de l’UE dans sa forme actuelle est qu’il s’agit d’une UE de marché, mais différente de celle envisagée lors des négociations de Maastricht sur le marché intérieur et certainement différente de celle que Milward avait en tête. Le problème du traité de Maastricht est qu’il ne prévoit pas d’intégration sociale en contrepartie de l’intégration économique. Delors le souhaitait, mais Thatcher s’y est opposée avec succès. L’idée d’harmoniser les règles et les normes a été transposée dans le langage du benchmarking, des meilleures pratiques et de la méthode ouverte de coordination, qui ont tous abouti à une focalisation des États membres de l’UE sur la concurrence mutuelle et à une pression sur les normes sociales, une évolution que Mario Draghi critique dans son rapport sur la compétitivité de l’UE présenté à la Commission en 2024. Selon lui, la concurrence interne a empêché l’UE de s’unir pour faire face à la concurrence extérieure (Draghi 2024). Cette négligence pourrait s’avérer coûteuse à l’ère des empires.
En observant que ce sont précisément les questions sociales qui alimentent aujourd’hui les populistes et les nationalistes en Europe, Balibar, dans sa relecture de Milward et en référence à Draghi, apporte une contribution significative au débat sur l’avenir de l’Europe. Il ajoute un point important à l’appel de Habermas. Une Europe sociale contre le programme social des nationalistes. Avec une Europe forte sur le plan interne autour des questions sociales, où le degré de supranationalité ne détruit pas le débat, l’Europe peut s’ouvrir d’une nouvelle manière au Sud global dans une stratégie alternative à la concurrence entre empires qui se joue également dans le Sud. Il faut espérer que les idées de Balibar susciteront le débat et l’action dans une Europe qui cherche à se trouver. L’histoire n’est pas sans alternatives. La désintégration est également une option si rien n’est fait pour l’empêcher.
Traduction par DeepL et Bo Stråth de l’article Bo Stråth, « En världsordning i upplösning. Vad nu? 1. Imperiernas möte i Europa och Europas svar. » Statsvetenskaplig Tidskrift Vol 127 Nr 2 juin 2025.
À suivre :
« Un ordre mondial en dissolution. Et maintenant ? 2. Démocratie de faible intensité sans alternatives, nihilisme et le pouvoir des algorithmes. » Septembre 2025
« Un ordre mondial en dissolution. Et maintenant ? 3. Une Europe fondée sur des valeurs à l’ère du nihilisme. Vers un nomos pour une société mondiale. » Décembre 2025
Références:
Balibar, Etienne, 2025. « L’impossible possibilité de la fédération européenne : hier, aujourd’hui, demain ». Conférence publique, Institut d’études européennes, Université libre de Bruxelles, « Journée de l’Europe », 8 mai 2025.
Chafkin, Max, 2022. The Contrarian. Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power. Bloomsbury.
Draghi, Mario, 2024. Le rapport Draghi : Partie A. Une stratégie de compétitivité pour l’Europe. Partie B. Analyse et recommandations. Bruxelles : Commission européenne, 9 septembre 2024.
Frei, Norbert, 2025. « Der Westen, wie wir ihn kannten, ist weg » (L’Occident tel que nous le connaissions a disparu), Süddeutsche Zeitung, 23 mars 2025.
Fukuyama, Francis, 1992. La fin de l’histoire et le dernier homme. New York : Free Press.
Gilman, Nils, 2025. « A Planetary Geopolitical Realignment? » (Un réalignement géopolitique planétaire ?), Substack/Small Precautions, 19 mars 2025.
Habermas, Jürgen, 2025. « Für Europa ». Süddeutsche Zeitung, 21 mars 2025.
Heritage Foundation, 2024. « Project 2025 Mandate for Leadership. The Conservative Promise ». Disponible à l’adresse https://archive.org/details/2025_MandateForLeadership_FULL.
Huntington, Samuel, 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York : Simon & Schuster.
Huntington, Samuel, 2004. Who Are You? Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York : Simon & Schuster.
Kagan, Robert, 2003. Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. New York : Knopf.
Kagan, Robert, 2024. Rebellion. How Antiliberalism Is Tearing America Apart Again. Londres : W H Allen.
Land, Nick, 2022. The Dark Enlightenment. Imperium Press.
Milward, Alan, 1992. The European Rescue of the Nation-State. Londres : Routledge.
Nietzsche, Friedrich, 1891. Ainsi parlait Zarathoustra. Vol. 4. Leipzig
Nussbaum, Emily, 2024. Cue the Sun ! – The Invention of Reality TV. New York : Random House.
O’Toole, Fintan, 2025. « Shredding the Postwar Order », New York Review of Books, 24 avril 2025.
Slobodian, Quinn, 2023. Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World without Democracy. Londres : Allen Lane.
Stiglitz, Joseph, 2025. « Trump’s America: The New Global Tax Haven? », Social Europe, 30 avril 2025.
Stråth, Bo & Trüper, Henning, 2025. « Conceptualising Capitalism: Conversations with Henning Trüper. Blog 4. The Zeitgeist of Empire and Nihilism in Historical Perspective. And Capitalism? » Disponible à l’adresse https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/conceptualizing-.
Thiel, Peter, 2014. Zero to One : Notes sur les startups, ou comment construire l’avenir. New York : Random House.
Vance, J D, 2016. Hillbilly Elegy : Mémoires d’une famille et d’une culture en crise. Blackstone.
Weber, Max 1980 [1922]. Wirtschaft und Gesellschaft. Éd. Johannes Winckelmann : Tübingen : Mohr.
Westad, Odd Arne, 2005. The Global Cold War. Cambridge : Cambridge University Press.
Maison Blanche, 14 février 2025. Le vice-président JD Vance prononce un discours lors de la Conférence sur la sécurité de Munich. Disponible à l’adresse https://www.com/watch?v=pCOsgfINdKg
Déclaration de la Maison Blanche, 7 avril 2025. Disponible à l’adresse https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/04/cea-chairman-steve-miran-hudson-institute-event-remarks/CEA Remarques du président Steve Miran lors de l’événement organisé par le Hudson Institute – La Maison Blanche.
Yarvin, Curtis, 2024. Gray Mirror. Fascicule I : Disturbance. Passage Press.
Comment citer:
Cit. Bo Stråth, “Un ordre mondial en dissolution. Et maintenant ? 1. La rencontre des empires en Europe et la réponse de l’Europe.” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/un-ordre-mondial-en-dissolution-et-maintenant/ Published 06.07.2025
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.